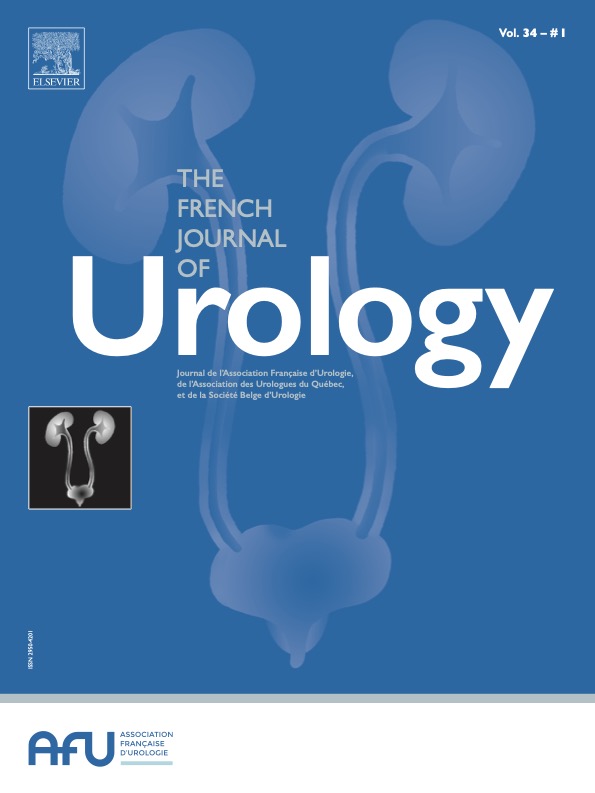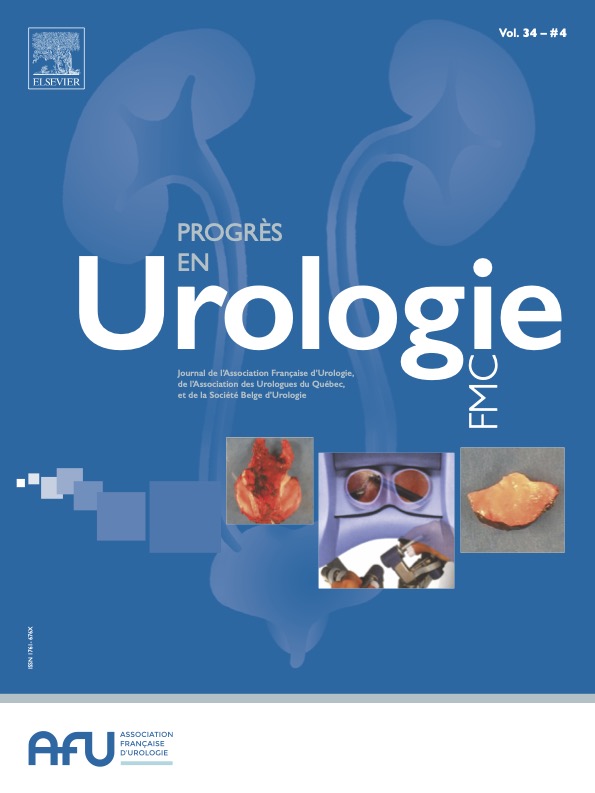Array
(
[post_type] => post
[paged] => 3
[tax_query] => Array
(
[0] => Array
(
[taxonomy] => category
[field] => id
[terms] => 1
[operator] => IN
)
)
[meta_key] => eventdate
[meta_value] => 20240419
[meta_compare] => <
[meta_type] => DATE
[orderby] => date
[order] => DESC
[category__not_in] => 5450
[posts_per_page] => 13
)
WP_Query Object
(
[query] => Array
(
[post_type] => post
[paged] => 3
[tax_query] => Array
(
[0] => Array
(
[taxonomy] => category
[field] => id
[terms] => 1
[operator] => IN
)
)
[meta_key] => eventdate
[meta_value] => 20240419
[meta_compare] => <
[meta_type] => DATE
[orderby] => date
[order] => DESC
[category__not_in] => 5450
[posts_per_page] => 13
)
[query_vars] => Array
(
[post_type] => post
[paged] => 3
[tax_query] => Array
(
[0] => Array
(
[taxonomy] => category
[field] => id
[terms] => 1
[operator] => IN
)
)
[meta_key] => eventdate
[meta_value] => 20240419
[meta_compare] => <
[meta_type] => DATE
[orderby] => date
[order] => DESC
[category__not_in] => Array
(
[0] => 5450
)
[posts_per_page] => 13
[error] =>
[m] =>
[p] => 0
[post_parent] =>
[subpost] =>
[subpost_id] =>
[attachment] =>
[attachment_id] => 0
[name] =>
[pagename] =>
[page_id] => 0
[second] =>
[minute] =>
[hour] =>
[day] => 0
[monthnum] => 0
[year] => 0
[w] => 0
[category_name] => historique-des-actualites
[tag] =>
[cat] => 1
[tag_id] =>
[author] =>
[author_name] =>
[feed] =>
[tb] =>
[preview] =>
[s] =>
[sentence] =>
[title] =>
[fields] =>
[menu_order] =>
[embed] =>
[category__in] => Array
(
)
[category__and] => Array
(
)
[post__in] => Array
(
)
[post__not_in] => Array
(
)
[post_name__in] => Array
(
)
[tag__in] => Array
(
)
[tag__not_in] => Array
(
)
[tag__and] => Array
(
)
[tag_slug__in] => Array
(
)
[tag_slug__and] => Array
(
)
[post_parent__in] => Array
(
)
[post_parent__not_in] => Array
(
)
[author__in] => Array
(
)
[author__not_in] => Array
(
)
[search_columns] => Array
(
)
[ignore_sticky_posts] =>
[suppress_filters] =>
[cache_results] => 1
[update_post_term_cache] => 1
[update_menu_item_cache] =>
[lazy_load_term_meta] => 1
[update_post_meta_cache] => 1
[nopaging] =>
[comments_per_page] => 50
[no_found_rows] =>
)
[tax_query] => WP_Tax_Query Object
(
[queries] => Array
(
[0] => Array
(
[taxonomy] => category
[terms] => Array
(
[0] => 1
)
[field] => id
[operator] => IN
[include_children] => 1
)
[1] => Array
(
[taxonomy] => category
[terms] => Array
(
[0] => 5450
)
[field] => term_id
[operator] => NOT IN
[include_children] =>
)
)
[relation] => AND
[table_aliases:protected] => Array
(
[0] => akn_term_relationships
)
[queried_terms] => Array
(
[category] => Array
(
[terms] => Array
(
[0] => 1
)
[field] => id
)
)
[primary_table] => akn_posts
[primary_id_column] => ID
)
[meta_query] => WP_Meta_Query Object
(
[queries] => Array
(
[0] => Array
(
[key] => eventdate
[compare] => <
[type] => DATE
[value] => 20240419
)
[relation] => OR
)
[relation] => AND
[meta_table] => akn_postmeta
[meta_id_column] => post_id
[primary_table] => akn_posts
[primary_id_column] => ID
[table_aliases:protected] => Array
(
[0] => akn_postmeta
)
[clauses:protected] => Array
(
[akn_postmeta] => Array
(
[key] => eventdate
[compare] => <
[type] => DATE
[value] => 20240419
[compare_key] => =
[alias] => akn_postmeta
[cast] => DATE
)
)
[has_or_relation:protected] =>
)
[date_query] =>
[request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS akn_posts.ID
FROM akn_posts LEFT JOIN akn_term_relationships ON (akn_posts.ID = akn_term_relationships.object_id) LEFT JOIN akn_postmeta ON (akn_posts.ID = akn_postmeta.post_id AND akn_postmeta.meta_key = 'eventdate')
WHERE 1=1 AND (
akn_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1)
AND
akn_posts.ID NOT IN (
SELECT object_id
FROM akn_term_relationships
WHERE term_taxonomy_id IN (5450)
)
) AND (akn_postmeta.meta_value IS NULL OR akn_postmeta.meta_value > '2024-04-19 17:37:11') AND ((akn_posts.post_type = 'post' AND (akn_posts.post_status = 'publish' OR akn_posts.post_status = 'acf-disabled')))
GROUP BY akn_posts.ID
ORDER BY akn_posts.post_date DESC
LIMIT 26, 13
[posts] => Array
(
[0] => WP_Post Object
(
[ID] => 84081
[post_author] => 6350
[post_date] => 2021-11-20 12:20:15
[post_date_gmt] => 2021-11-20 11:20:15
[post_content] =>
Les recommandations du comité de cancérologie de l’AFU sur la prise en charge des effets indésirables de la BCG-thérapie pour le traitement des tumeurs de la vessie ont presque 10 ans. Faut-il les actualiser ? L’amélioration des connaissances sur les antibiothérapies à BCG semble inviter au repositionnement des stratégies en infectiologie.
La BCG-thérapie pour le traitement des tumeurs vésicales est aussi efficace qu’elle peut se révéler toxique, avec son lot d’effets indésirables plus ou moins graves. Selon la littérature, seuls 16 % des patients tolèrent le schéma thérapeutique complet préconisé par Laam : 6 doses d’induction puis 3 doses à 3 mois, à 6 mois, à 1 an et tous les 6 mois jusqu’à 36 mois. Réduire la durée de la cure ou les doses pour essayer d’améliorer la tolérance conduit à une baisse d’efficacité du traitement. Seule approche possible pour contrôler la toxicité, prendre en charge le plus précocement possible les effets indésirables. Quels sont ces effets ?
Les principales complications
Deux grands types de complications existent. Les premières, locales, prennent la forme d’une infection urinaire à BCG avec syndrome irritatif de la vessie, d’une pollakiurie, d’une infection des testicules, de la présence de sang dans les urines, de brûlures à la miction… Fréquentes, elles n’ont pas de caractère de gravité. Les secondes sont d’ordre systémique. Plus rares mais plus graves pour certaines, elles se traduisent par de la fièvre, de l’arthrite, une ulcération des organes géniaux externes, une prostatite aigüe… voire par l’atteinte d’autres organes : les poumons avec miliaire tuberculeuse, le foie, les os, les reins, le cœur, etc. « Très graves mais peu fréquentes, ces atteintes d’organes mettent en jeu le pronostic vital et imposent l’arrêt définitif du traitement », souligne Fabien Saint. « Trois hypothèses physiopathologiques peuvent expliquer ces complications, poursuit-il : une dissémination du BCG, une hypersensibilité locale, la réactivation de mycobactéries dormantes ».
Des effets indésirables difficiles à éviter
Comment prévenir les effets indésirables d’une BCG-thérapie ? Yann Neuzillet rappelle les situations incompatibles avec la cure, notamment la présence d’une cystite active ou une immunosuppression. Concernant la prévention des effets indésirables peu sévères, l’étude de Marc Colombel préconise la dispensation de fluoroquinolones per-os 6 heures puis 18 heures après l’instillation de BCG. Si ce protocole atténue les effets indésirables, « il ne réduit pas leur inconfort, ce qui amène souvent les patients à demander l’arrêt de la cure », souligne Yann Neuzillet. Autre obstacle, l’efficacité des fluroquinolones est contrebalancée par une sélection des germes résistants (staphylocoque doré multirésistant…).
Que faire face à ces complications ? « Concernant les infections locales, il faut discuter de la suspension temporaire des instillations de BCG », indique Fabien Saint. Pour les complications les plus graves, il attire l’attention sur la typicité des symptômes : de la fièvre et une altération rapide de l’état général. « Il faut savoir penser aux effets d’une BCG-thérapie, même à distance d’une instillation », préconise-t-il. Une réponse thérapeutique rapide est indispensable.
Pierre Derrouch
|
Pénurie du BCG, l’AFU en première ligne
Début 2021, le principal fournisseur de BCG pour la France a annoncé l’arrêt de chaînes de production d’un sous-traitant pour des travaux d’amélioration. Pour anticiper une pénurie transitoire, « un contingentement des approvisionnements basé sur les recommandations de l’AFU et validé par l’ANSM, complété par le recours à une souche danoise ensuite, a permis de répondre aux attentes des patients », rapporte Yann Neuzillet. De quoi couvrir les besoins mensuels de BCG en France évalués à 9 500 doses en moyenne.
|
Crédit photo : © Shidlovski
[post_title] => Tumeurs de la vessie, de la bonne gestion des effets indésirables de la BCG-thérapie
[post_excerpt] =>
[post_status] => publish
[comment_status] => open
[ping_status] => open
[post_password] =>
[post_name] => tumeurs-de-la-vessie-de-la-bonne-gestion-des-effets-indesirables-de-la-bcg-therapie
[to_ping] =>
[pinged] =>
[post_modified] => 2022-04-25 17:53:15
[post_modified_gmt] => 2022-04-25 15:53:15
[post_content_filtered] =>
[post_parent] => 0
[guid] => https://www.urofrance.org/?p=84081
[menu_order] => 0
[post_type] => post
[post_mime_type] =>
[comment_count] => 0
[filter] => raw
)
[1] => WP_Post Object
(
[ID] => 72058
[post_author] => 6350
[post_date] => 2021-09-17 10:33:46
[post_date_gmt] => 2021-09-17 08:33:46
[post_content] => Le prochain Congrès Français d'Urologie se déroulera du 17 au 20 novembre 2021. En présentiel ou en distanciel, cliquez pour tout savoir sur le CFU
[post_title] => Le CFU approche, les inscriptions sont ouvertes !
[post_excerpt] =>
[post_status] => publish
[comment_status] => open
[ping_status] => open
[post_password] =>
[post_name] => le-cfu-approche-les-inscriptions-sont-ouvertes
[to_ping] =>
[pinged] =>
[post_modified] => 2021-09-17 10:37:06
[post_modified_gmt] => 2021-09-17 08:37:06
[post_content_filtered] =>
[post_parent] => 0
[guid] => https://www.urofrance.org/?p=72058
[menu_order] => 0
[post_type] => post
[post_mime_type] =>
[comment_count] => 0
[filter] => raw
)
[2] => WP_Post Object
(
[ID] => 78865
[post_author] => 1
[post_date] => 2021-05-07 00:00:00
[post_date_gmt] => 2021-05-06 22:00:00
[post_content] =>
Le cancer du rein fait partie des cancers les plus mortels et se situe en 3ème position du cancer de l'appareil urinaire le plus fréquent après le cancer de la prostate et les tumeurs urothéliales. Chaque année près de 15 000 cas sont diagnostiqués et ce chiffre tend à augmenter grâce à l'amélioration des techniques d'imagerie. Toutefois, pour mieux prévenir le cancer du rein, il est important de mieux connaitre les facteurs de risques.
Des facteurs de risques modifiables
Le cancer du rein touche davantage les hommes que les femmes et apparait en moyenne à l'âge de 70 ans pour les femmes et 3 ans plus tôt pour les hommes.1
Il existe de nombreux facteurs de risques connus pour favoriser le cancer du rein. C'est notamment le cas du tabac, de l'hypertension artérielle ou encore de l'obésité. Certaines maladies peuvent également multiplier le risque de cancer du rein comme l'insuffisance rénale chronique. Aussi, la consommation fréquente de certains médicaments tels que les antalgiques, comme l'aspirine, le paracétamol ou encore l'ibuprofène, pourrait entrainer un risque plus élevé de cancer du rein. Des études plus poussées doivent être menées pour confirmer ce risque mais des précautions d'emploi semblent dans tous les cas nécessaires, comme d'ailleurs pour tout usage de médicaments.
Dans un autre registre, depuis quelques années, les scientifiques suspectent qu'une exposition prolongée aux radiations ionisantes pourraient entrainer un risque important de cancer du rein. L'exposition à d'autres agents dans le cadre d'activités professionnelles comme le trichloroéthylène, un solvant utilisé pour le dégraissage dans l'industrie ou bien encore le cadmium, utilisé en métallurgie et l'arsenic sont de potentiels facteurs de risques. 2,3,4
Des facteurs de risques génétiques
Plus rarement, il est possible de souffrir d'un cancer du rein lié à des formes familiales. C'est le cas pour 5% des cancers du rein. La forme héréditaire la plus fréquente est le syndrome de Von Hippel-Lindau (VHL) et concerne environ 200 familles en France. Afin de prévenir la survenue d'un cancer héréditaire, il est utile de bénéficier d'une consultation dite d'oncogénétique. Il s'agit d'une consultation qui permet d'évaluer le risque d'une prédisposition génétique en fonction notamment de son histoire familiale et de son âge. Si une mutation génétique est découverte, cela permet de mettre en place un meilleur suivi médical pour les patients et les membres à risque de sa famille.
Les facteurs de risque modifiables sont faciles à prévenir comme l'arrêt du tabac, l'adoption d'une alimentation saine et peu salée, ou bien encore une consommation raisonnable de médicaments antalgiques en respectant les dosages prescrits par son médecin traitant. Adopter de bonnes habitudes de vie permet de prévenir aussi d'autres cancers et maladies chroniques. Les facteurs de risques génétiques quant à eux, peuvent être pris en charge le plus tôt possible grâce à l'aide d'une consultation d'oncogénétique.
Sources :
- https://www.urofrance.org/base-bibliographique/cancer-sporadique-du-rein-chez-les-patients-de-moins-de-45-ans#:~:text=Le%20cancer%20du%20rein%20est,chez%20la%20femme%20%5B1%5D.
- Buhagen M, Grønskag A, Ragde SF, Hilt B. Association Between Kidney Cancer and Occupational Exposure to Trichloroethylene. J Occup Environ Med. 2016;58(9):957-959. doi:10.1097/JOM.0000000000000838
- Hsueh Y-M, Lin Y-C, Huang Y-L, et al. Effect of plasma selenium, red blood cell cadmium, total urinary arsenic levels, and eGFR on renal cell carcinoma. Sci Total Environ. 2021;750:141547. doi:10.1016/j.scitotenv.2020.141547
- Abdul KSM, Jayasinghe SS, Chandana EPS, Jayasumana C, De Silva PMCS. Arsenic and human health effects: A review. Environ Toxicol Pharmacol. 2015;40(3):828-846. doi:10.1016/j.etap.2015.09.016
[post_title] => Mieux connaître les facteurs de risques du cancer du rein
[post_excerpt] =>
[post_status] => publish
[comment_status] => open
[ping_status] => open
[post_password] =>
[post_name] => mieux-connaitre-les-facteurs-de-risques-du-cancer-du-rein
[to_ping] =>
[pinged] =>
[post_modified] => 2021-05-07 00:00:00
[post_modified_gmt] => 2021-05-06 22:00:00
[post_content_filtered] =>
[post_parent] => 0
[guid] => https://www.urofrance.org/2021/05/07/mieux-connaitre-les-facteurs-de-risques-du-cancer-du-rein/
[menu_order] => 0
[post_type] => post
[post_mime_type] =>
[comment_count] => 0
[filter] => raw
)
[3] => WP_Post Object
(
[ID] => 79052
[post_author] => 1
[post_date] => 2021-05-06 00:00:00
[post_date_gmt] => 2021-05-05 22:00:00
[post_content] =>
Chers collègues,
Le mois de Mai est traditionnellement celui des mouvements sociaux et week-end prolongés par de multiples ponts. Avec l'Association Française d'Urologie et l'association de patients Les Zuros Cancer Vessie France, nous allons faire de ce joli mois de Mai le mois de la mobilisation contre le cancer de la vessie.
Dans sa nouvelle mandature, le conseil d'administration de l'AFU redouble d'efforts pour réduire la mortalité liée aux cancers urologiques. Le cancer de la vessie demeure le plus mortel d'entre eux, souvent parce que diagnostiqué tardivement.
L'hématurie est LE symptôme d'alarme qui nous oriente vers la recherche d'un cancer vésical. Vous, vous le savez, mais les patients, eux, l'ignorent. L'enquête menée par l'alliance Merck-Pfizer auprès du grand public a révélé la nécessité d'informer les patients pour diagnostiquer au plus tôt et traiter au mieux les cancers de la vessie.
Ainsi, tout au long de ce mois, il va y avoir du buzz dans la presse et sur les réseaux sociaux pour mieux faire connaitre le cancer de la vessie. Nous tous, urologues membres de l'AFU, sommes impliqués dans ce grand évènement.
Pr Yann Neuzillet
Responsable du CCAFU VESSIE et secrétaire général adjoint de l'AFU


[post_title] => Cancer de la vessie : un cancer trop souvent oublié, aux facteurs de risques minimisés !
[post_excerpt] =>
[post_status] => publish
[comment_status] => open
[ping_status] => open
[post_password] =>
[post_name] => cancer-de-la-vessie-un-cancer-trop-souvent-oublie-aux-facteurs-de-risques-minimises
[to_ping] =>
[pinged] =>
[post_modified] => 2021-05-06 00:00:00
[post_modified_gmt] => 2021-05-05 22:00:00
[post_content_filtered] =>
[post_parent] => 0
[guid] => https://www.urofrance.org/2021/05/06/cancer-de-la-vessie-un-cancer-trop-souvent-oublie-aux-facteurs-de-risques-minimises/
[menu_order] => 0
[post_type] => post
[post_mime_type] =>
[comment_count] => 0
[filter] => raw
)
[4] => WP_Post Object
(
[ID] => 78866
[post_author] => 1
[post_date] => 2021-04-23 00:00:00
[post_date_gmt] => 2021-04-22 22:00:00
[post_content] =>
La résistance des bactéries aux antibiotiques est un enjeu majeur de la médecine pour les générations à venir. Les enterobactéries productrices de bétalactamases à spectre étendu sont de ces bactéries, et les urologues ont de plus en plus affaires à elles. Décryptage avec le Pr Franck Bruyère, responsable du comité d'infectiologie de l'AFU.
Les bactéries productrices de BLSE en urologie
Depuis plusieurs années en urologie, on constate une augmentation progressive des bactéries productrices de BLSE c'est à dire de bétalactamases à spectre étendu. Ces bétalactamases sont des enzymes qui confèrent à la bactérie la capacité de survivre à certains antibiotiques jusqu'alors efficaces, les bétalactamines. Il s'agit donc d'un mécanisme de défense que la bactérie développe en réponse à une agression, ainsi cette augmentation de cas de bactérie productrice de BLSE est liée principalement à la consommation antibiotique.
En effet, « plus on prescrit de bétalactamines plus on a en réponse un mécanisme de résistance avec une production de bétalactamases » nous explique Pr Franck Bruyère. Cette résistance peut être retrouvée chez des bactéries bien connues en urologie que sont les entérobactéries et notamment Escherichia coli, une bactérie présente dans la flore intestinale et responsable d'infections urinaires. La proportion de ces bactéries productrices de BLSE augmente progressivement depuis des années « sans être pour le moment alarmant » précise Pr Franck Bruyère.
La présence ou la suspicion d'une BLSE impose cependant l'utilisation d'autres antibiotiques ce qui risque d'entrainer l'apparition de nouveaux mécanismes de défense et de nouvelles résistances à ces antibiotiques. Cependant « de nouveaux antibiotiques sont en cours de développement dans ce cadre » nous rassure Pr Franck Bruyère.
Quel impact pour le patient ?
Premièrement, la présence de BLSE n'est pas à risque d'infection plus grave. En effet, « on pense que plus les germes sont résistants moins ils sont virulents, la problématique réside essentiellement dans le manque de traitement disponible efficace sur ces souches » précise Pr Franck Bruyère.
Lors des premiers jours le traitement de l'infection est dit probabiliste, c'est à dire que l'on prescrit le médicament qui a le plus de chance d'être efficace contre la bactérie que l'on suspecte. En effet l'identification de la bactérie et des antibiotiques efficaces pour l'éradiquer peut prendre 48 à 72h. Ainsi la suspicion de BLSE doit faire modifier le traitement probabiliste au profit de molécules reconnues plus efficaces sur ces souches. Il convient donc pour le médecin de rechercher les facteurs de risques d'infection par BLSE :
- la prise d'un antibiotique dans les 6 derniers mois
- un voyage dans les 6 derniers mois en zone d'endémie
- la présence connue d'une bactérie productrice de BLSE récemment
- une hospitalisation dans les 3 mois précédents
- une vie en établissement de long séjour
En cas de présence d'un de ces critères, une modification de la prescription d'antibiotique devra être envisagée.
[post_title] => Les Enterobactéries productrices de BLSE : Le dilemme de l'antiobiorésistance
[post_excerpt] =>
[post_status] => publish
[comment_status] => open
[ping_status] => open
[post_password] =>
[post_name] => les-enterobacteries-productrices-de-blse-le-dilemme-de-lantiobioresistance
[to_ping] =>
[pinged] =>
[post_modified] => 2021-04-23 00:00:00
[post_modified_gmt] => 2021-04-22 22:00:00
[post_content_filtered] =>
[post_parent] => 0
[guid] => https://www.urofrance.org/2021/04/23/les-enterobacteries-productrices-de-blse-le-dilemme-de-lantiobioresistance/
[menu_order] => 0
[post_type] => post
[post_mime_type] =>
[comment_count] => 0
[filter] => raw
)
[5] => WP_Post Object
(
[ID] => 78867
[post_author] => 1
[post_date] => 2021-04-16 00:00:00
[post_date_gmt] => 2021-04-15 22:00:00
[post_content] =>
Lumière sur la maladie de Mondor de la verge (ou thrombose superficielle de verge), une pathologie encore largement méconnue avec le Dr Antoine Faix, ancien Responsable du Comité d'Andrologie et de Médecine Sexuelle de l'AFU.
Une affection méconnue
La maladie de Mondor de la verge est une affection relativement rare bien que « l'on ne dispose que de peu de chiffres et très peu de publications sur le sujet » nous explique le Dr Antoine Faix.
Elle consiste initialement en une phlébite, c'est à dire un caillot dans une veine superficielle au niveau du thorax ou de l'abdomen. Elle a classiquement été décrite chez la femme qui allaite ou après un traitement par radiothérapie dans la région où se produit le caillot ou souvent sans cause connue.
Cette pathologie peut être retrouvée dans d'autres endroits du corps humain, notamment au niveau de la verge. Elle touche alors une petite veine superficielle se situant sur le dessus de la verge qui va s'obstruer, c'est la thrombose. Elle est principalement responsable de douleur, pouvant rendre douloureux voire difficiles les rapports sexuels notamment.
« La plupart du temps, il s'agit d'homme jeune ayant eu une activité sexuelle intense » nous explique Antoine Faix. Le mécanisme exact n'est pas connu mais il semblerait qu'une compression empêchant le bon retour veineux notamment à la base de verge puisse favoriser la survenue de ces thromboses superficielles de verge, notamment en cas d'utilisation de cock-ring (un anneau se plaçant à la base de la verge en vue de renforcer et de prolonger une érection).
Un diagnostic clinique
Le diagnostic est avant tout clinique et l'urologue recherchera lors de l'examen clinique une veine indurée et douloureuse à la palpation de la verge. Une échographie doppler (permettant de voir les vaisseaux) de verge peut être proposée pour affirmer le diagnostic mais n'est pas indispensable en cas de signes cliniques évocateurs concordant avec des facteurs de risque évidents.
La plupart du temps les symptômes disparaissent tout seuls en 4 à 8 semaines mais parfois ils peuvent perdurer plusieurs mois. En cas de persistance ou si aucun facteurs de risque n'est retrouvé à l'interrogatoire, l'urologue s'assurera de l'absence d'une autre pathologie associée ou sous-jacente. « On pourra rechercher une anomalie de la fluidité sanguine, une compression veineuse, une IST (infection sexuellement transmissible) ou une maladie de Lapeyronie (courbure de verge) » nous indique le Pr Faix. Cette recherche nécessite alors la réalisation d'une prise de sang, d'une échographie du bas ventre et des organes génitaux et surtout d'un interrogatoire exhaustif.
Un traitement empirique
Bien qu'il n'y ait pas de recommandations scientifiques actuellement, son traitement reste le plus souvent simple avec des médicaments par voie orale. Dans les premières semaines un traitement des symptômes douloureux par des anti-inflammatoires et des antalgiques peut être proposé, associé à des massages quotidiens de la veine dorsale de la verge pour faciliter la résorption du caillot.
En cas de persistance passé un délai de 4 à 8 semaine des traitements pour fluidifier le sang, peuvent être introduits et ce pour une durée de 4 à 8 semaines.
Exceptionnellement une intervention chirurgicale consistant à retirer la veine bouchée peut être indiquée en cas de persistance, malgré les traitements, de symptômes douloureux invalidants.
[post_title] => Thrombose superficielle de la verge
[post_excerpt] =>
[post_status] => publish
[comment_status] => open
[ping_status] => open
[post_password] =>
[post_name] => thrombose-superficielle-de-la-verge
[to_ping] =>
[pinged] =>
[post_modified] => 2021-04-16 00:00:00
[post_modified_gmt] => 2021-04-15 22:00:00
[post_content_filtered] =>
[post_parent] => 0
[guid] => https://www.urofrance.org/2021/04/16/thrombose-superficielle-de-la-verge/
[menu_order] => 0
[post_type] => post
[post_mime_type] =>
[comment_count] => 0
[filter] => raw
)
[6] => WP_Post Object
(
[ID] => 78869
[post_author] => 1
[post_date] => 2021-04-09 00:00:00
[post_date_gmt] => 2021-04-08 22:00:00
[post_content] =>
L'incontinence urinaire (IU) touche des milliers de femmes en France de tous âges confondus avec des répercussions défavorables sur la qualité de vie entrainant un véritable enjeu de santé publique. Pour le Pr Jean-François Hermieu (Hôpital Bichat, AP-HP), membre du comité d'urologie et de périnéologie de la femme), l'amélioration des solutions thérapeutiques contribuera à lever progressivement le tabou. C'est un des rôles essentiels des professionnels de santé et des sociétés savantes.
L'incontinence urinaire : un tabou pour le patient et pour le médecin
L'incontinence urinaire correspond à une perte involontaire d'urine par l'urètre.
Les fuites peuvent être à l'effort et liées le plus souvent à une faiblesse des muscles du plancher pelvien (périnée) qui font suite à une grossesse, à un accouchement avec facteur de risque ou de simple relâchement musculaire lié au vieillissement. Elles surviennent en cas d'effort physique, d'un épisode de toux ou d'un simple rire.
Elles peuvent également être liées à des envies pressantes et trop urgentes sans possibilité de se retenir. Il s'agit dans ce cas d'incontinence par urgenturies dont le mécanisme est lié à une hyperactivié du muscle vésical.
Ce mécanisme de fuites par urgenturies touche aussi bien les hommes que les femmes et constitue une pathologie plus gênante que le diabète en qualité de vie.
Vécue comme un handicap humiliant, l'incontinence urinaire a pour conséquences le repli sur soi et l'isolement social [1, 2].
« Le tabou lié à l'incontinence connaît une évolution favorable depuis quelques années au travers de la presse féminine, de la presse santé et de la télévision. Les personnes commencent à voir que ce n'est pas une fatalité », explique le Pr Hermieu. Néanmoins, le recours au soin ne dépasse pas 30 % parmi les incontinents. Le niveau de gêne liée à l'incontinence est très marqué, voire plus prononcé que celle ressentie pour les infections sexuellement transmissibles, les troubles de l'érection ou la sexualité. Un fait marquant, note le Pr Jean-François Hermieu, est « la surévaluation faite par les médecins du tabou ressenti par les patients. L'IU est plus évaluée comme un tabou par les généralistes que par les patients eux-mêmes ».
Ainsi, le tabou serait plus important chez les médecins généralistes qui hésitent à faire des investigations plus longues par manque de temps médical dans un quotidien déjà très chargé. De plus, le cursus des études de médecine comporte très peu d'enseignements sur cette thématique, et peu de familiarité avec ces symptômes.
En revanche, les patients sont plus enclins à aborder cette pathologie avec leur gynécologue mais son approche sera plus orientée vers l'incontinence d'effort qu'à celle par urgenturie. D'une manière générale, lorsque le sujet est abordé avec le médecin, les patients se déclarent généralement satisfaits des réponses fournies et plus à l'aise. Il semble donc que libérer la parole soulage l'ensemble des parties prenantes, pour le bien de toutes et tous.
Modalités de prise en charge thérapeutique
L'urologue a une place centrale, en tant que spécialiste de l'appareil urinaire, dans la prise en charge diagnostique, l'évaluation, la prise en charge (par rééducation, ou médicale et parfois chirurgicale) et le suivi des différents types d'incontinence. L'examen clinique uro-gynécologique est un élément clef. D'autres examens complémentaires peuvent être réalisés à la demande ou par l'urologue (comme le bilan urodynamique par exemple.
Aujourd'hui, la prise en charge de l'incontinence urinaire d'effort féminine est très efficace et se fait grâce à la rééducation périnéale et si besoin grâce aux bandelettes sous-urétrales. Des mesures d'hygiène de vie comme la perte de poids permettent également d'améliorer les symptomes.
En revanche, « pour les symptômes d'urgenturie avec ou sans incontinence urinaire, les traitements sont plus complexes et d'efficacité variable » précise le Pr Hermieu. Les médicaments peuvent être responsable d'effets secondaires (comme la constipation ou la sécheresse buccale) qui limitent leur observance.
En cas d'hyperactivité vésicale, le Pr Hermieu rappelle que « cela peut être le signe d'une maladie plus sévère ». Il faut s'assurer de la cause avant de conclure à un traitement et éliminer un diagnostic comme une tumeur vésicale, une sclérose en plaques ou d'un prolapsus génital.
D'autres techniques sont possibles dans les formes sévères comme la stimulation du nerf tibial postérieur par l'intermédiaire d'électrodes collées au niveau de la cheville avec une efficacité démontrée sans les effets secondaires des médicaments. L'appareil est pris en charge par les organismes sociaux en location puis à l'achat. Enfin des traitements chirurgicaux comme l'injection de botox à l'intérieur de la vessie permettent de traiter les symptômes résistants au traitement médicamenteux. La neuromodulation sacrée (appareil posé au bloc opératoire permettant de stimuler les racines nerveuses sacrés) est également une option surtout en cas d'incontinence fécale associée.
Références
[1] Hu TW, Wagner TH, Bentkover JD, Leblanc K, Zhou SZ, Hunt TL. Costs of urinary incontinence and overactive bladder in the United States: A comparative study. Urology 2004;63:4615.
[2] Johannesson M, O'Conor R, Kobelt-Nguyen G, Mattiasson A. Willingness to pay for reduced incontinence symptoms. Br J Urol 1997;80:55762.
[post_title] => L'incontinence urinaire par fuites à l'effort ou par envies urgentes est un tabou à lever
[post_excerpt] =>
[post_status] => publish
[comment_status] => open
[ping_status] => open
[post_password] =>
[post_name] => lincontinence-urinaire-par-fuites-a-leffort-ou-par-envies-urgentes-est-un-tabou-a-lever
[to_ping] =>
[pinged] =>
[post_modified] => 2021-04-09 00:00:00
[post_modified_gmt] => 2021-04-08 22:00:00
[post_content_filtered] =>
[post_parent] => 0
[guid] => https://www.urofrance.org/2021/04/09/lincontinence-urinaire-par-fuites-a-leffort-ou-par-envies-urgentes-est-un-tabou-a-lever/
[menu_order] => 0
[post_type] => post
[post_mime_type] =>
[comment_count] => 0
[filter] => raw
)
[7] => WP_Post Object
(
[ID] => 78870
[post_author] => 1
[post_date] => 2021-04-02 00:00:00
[post_date_gmt] => 2021-04-01 22:00:00
[post_content] =>
L'imagerie médicale est une discipline utilisée aussi bien à des fins diagnostiques qu'à des fins thérapeutiques et dont les techniques évoluent constamment afin d'améliorer la prise en charge globale des cancers et notamment du cancer de la prostate. Le Dr Mathieu Gauthé, médecin nucléaire à l'hôpital Tenon, nous fait un point sur ces avancées et nous confie également quelques points de vigilance.
Vers un diagnostic plus performant
Ces dernières années, les techniques de médecine nucléaire ont beaucoup évolué pour améliorer la prise en charge du cancer de la prostate. C'est notamment le cas de l'imagerie dite aux ligands du PSMA qui est une nouveauté. Le but de cette technique est de cartographier les métastases, d'évaluer leur localisation et leur nombre afin de proposer des solutions thérapeutiques ciblées, plus adaptées, à la situation du patient. Cette technique d'imagerie est à ce jour, la plus précise possible et permet d'éviter de passer à côté d'un mauvais diagnostic.
Gagner de l'espérance de vie et une meilleure qualité de vie
L'un des buts ultimes de la médecine nucléaire et particulièrement de la thérapie vectorisée est in fine d'améliorer la qualité de vie des patients atteints de cancer de la prostate et d'augmenter leur espérance de vie. Le Dr Mathieu Gauthé nous explique que le principe de la thérapie vectorisée est d'avoir une cible cellulaire précise afin de détruire les cellules cancéreuses en évitant le plus possible de toucher aux tissus sains. Il nous précise cependant que la thérapie vectorisée concerne pour le moment, uniquement les personnes ayant des métastases et pour lesquelles les traitements classiques n'ont pas fonctionné. Il s'agit donc d'une option thérapeutique supplémentaire pour les équipes médicales et non d'une prise en charge systématique pour tous les patients atteints de cancer de la prostate.
La thérapie vectorisée en pratique
En pratique, les médecins nucléaires avant d'identifier le meilleur traitement anticancéreux, effectuent d'abord une imagerie TEP aux ligands du PSMA. Lorsque cette imagerie est positive, le traitement vectorisé est délivré de manière ciblée sur les cellules cancéreuses grâce à ces mêmes ligands. Dans le jargon médical, on appelle cela la RIV ou radiothérapie interne vectorisée. C'est une technique efficace avec a priori, une meilleure tolérance par les patients.
Encore un peu de patience
Le Dr Gauthé nous confie qu'actuellement plusieurs études sont en cours et semblent démontrer que l'utilisation de la thérapie vectorisée pour les cas de cancers de la prostate résistants peut être intéressant. En revanche, on ne connait pas encore les résultats définitifs de ces études. Cela signifie qu'il n'y a, à ce jour, pas encore d'autorisation de mise sur le marché (AMM) en France. L'AMM est une obligation incontournable avant la mise à disposition d'un médicament. S'il n'y a pas cette autorisation, de fait, il n'y a pas encore de prix fixé pour ces nouveaux médicaments radiopharmaceutiques. Ils sont donc actuellement utilisés sous des conditions règlementaires très strictes, par exemple dans le cadre d'une autorisation temporaire d'utilisation nominative ou ATU. Ce cas de figure est envisageable uniquement si le patient concerné ne peut être inclus dans un essai thérapeutique et lorsque toutes les options habituelles avec AMM ont été utilisées comme l'imagerie TEP à la fluorocholine ou à la fluciclovine. Le Dr Gauthé nous précise à ce sujet l'importance de ne pas oublier ce qui existe déjà et qui fonctionne très bien pour certains patients.
Un avenir prometteur
L'arrivée de nouvelles techniques de médecine nucléaire comme celle des ligands du PSMA sont très prometteuses dans la prise en charge du cancer de la prostate, aussi bien sur le plan diagnostic que thérapeutique et participeront sans doute dans un avenir proche, l'amélioration de la qualité de vie des patients atteints de cancer et résistants aux traitements habituels. Cependant, Dr Gauthé nous rappelle qu'il reste encore des réponses à apporter sur plusieurs points et notamment sur l'intérêt médico-économique de ces médicaments radiopharmaceutiques.
[post_title] => Médecine nucléaire, les dernières nouveautés de prise en charge du cancer de la prostate
[post_excerpt] =>
[post_status] => publish
[comment_status] => open
[ping_status] => open
[post_password] =>
[post_name] => medecine-nucleaire-les-dernieres-nouveautes-de-prise-en-charge-du-cancer-de-la-prostate
[to_ping] =>
[pinged] =>
[post_modified] => 2021-04-02 00:00:00
[post_modified_gmt] => 2021-04-01 22:00:00
[post_content_filtered] =>
[post_parent] => 0
[guid] => https://www.urofrance.org/2021/04/02/medecine-nucleaire-les-dernieres-nouveautes-de-prise-en-charge-du-cancer-de-la-prostate/
[menu_order] => 0
[post_type] => post
[post_mime_type] =>
[comment_count] => 0
[filter] => raw
)
[8] => WP_Post Object
(
[ID] => 78871
[post_author] => 1
[post_date] => 2021-03-11 00:00:00
[post_date_gmt] => 2021-03-10 23:00:00
[post_content] =>
En Octobre 2020 paraissait dans la fameuse revue médicale, The Lancet Oncology, un article rapportant les résultats d'une étude française plaçant la radiothérapie au centre du débat. Le Dr Paul Sargos, radiothérapeute à l'institut Bergonié, membre du comité de cancérologie de l'Association Française d'Urologie et auteur de cet article, nous éclaire sur la place de la radiothérapie après chirurgie pour les patients opérés d'un cancer de prostate.
La radiothérapie adjuvante qu'est-ce que c'est ?
La radiothérapie est un traitement utilisé dans la prise en charge des cancers. Elle utilise des rayons X pour détruire les cellules cancéreuses. La radiothérapie dite adjuvante consiste à proposer, selon certains critères, les rayons au patient directement après la chirurgie d'ablation de la prostate. Elle est proposée lorsque l'analyse au microscope de la tumeur conclu à un risque important de récidive. Elle est alors effectuée en laissant un délai de récupération de 3 mois après la chirurgie afin de ne pas compromettre à la cicatrisation locale. En effet, les rayons peuvent affecter également les tissus sains avoisinants, pouvant être responsable d'effets secondaires. Le respect de ce délai permet de limiter le risque d'effet indésirable urinaire (irritation, fuites) ou sexuel (impuissance) présents dans environ 10%, « ce qui est conséquent pour les patients » nous explique-t-il.
Le rattrapage précoce, pourquoi ?
Plus le délai entre les rayons et la chirurgie est court, plus il y a de risque de voir apparaître des effets indésirables. Ainsi, trois études (RAVES1, RADICALS2 et GETUG-AFU 173) ont tenté d'évaluer si l'augmentation de ce délai au maximum, c'est à dire en cas d'élévation du PSA, permettait de réduire les effets indésirables tout en conservant l'efficacité du traitement.
L'étude française (GETUG-AFU 17) retrouvait que le traitement par rayons ainsi différé pourrait diminuer les effets indésirables des rayons sans qu'il y ait de risque pour le patient concernant l'évolution du cancer.
Cependant Paul Sargos nous met en garde, « la fenêtre thérapeutique ciblée est étroite », puisqu'on estime que le PSA ne doit pas dépasser 0,5ng/mL pour que cette nouvelle stratégie soit pleinement efficace.
Vers un traitement personnalisé
L'objectif principal en radiothérapie reste de proposer le traitement le plus efficace avec le moins d'effets indésirables possible. Ainsi les progrès dans la technique des rayons ont permis de diminuer ces risques et c'est à présent la sélection des patients qui représente un enjeu important. En ce sens, l'analyse de ces études semble montrer que « même chez les patients à risque élevé, une stratégie différée fonctionne bien » nous explique Paul Sargos. Ce type de thérapie différé pourraient donc être proposée à une large sélection de patients, permettant de réduire de façon importante les effets indésirables lié à un traitement précoce.
« D'autres pistes sont également à l'étude » afin d'améliorer la sélection des patients, nous informe-t-il. En effet, selon lui les nouvelles imageries ou encore la génétique des tumeurs seront aussi des points clefs vers un traitement personnalisé.
Références :
- Adjuvant radiotherapy versus early salvage radiotherapy following radical prostatectomy (TROG 08.03/ANZUP RAVES): a randomised, controlled, phase 3, non-inferiority trial. Kneebone A, Fraser-Browne C, Duchesne GM, Fisher R, Frydenberg M, Herschtal A, Williams SG, Brown C, Delprado W, Haworth A, Joseph DJ, Martin JM, Matthews JHL, Millar JL, Sidhom M, Spry N, Tang CI, Turner S, Wiltshire KL, Woo HH, Davis ID, Lim TS, Pearse M.Kneebone A, et al. Lancet Oncol. 2020 Oct;21(10):1331-1340. doi: 10.1016/S1470-2045(20)30456-3.Lancet Oncol. 2020. PMID: 33002437 Clinical Trial.
- Timing of radiotherapy after radical prostatectomy (RADICALS-RT): a randomised, controlled phase 3 trial. Parker CC, Clarke NW, Cook AD, Kynaston HG, Petersen PM, Catton C, Cross W, Logue J, Parulekar W, Payne H, Persad R, Pickering H, Saad F, Anderson J, Bahl A, Bottomley D, Brasso K, Chahal R, Cooke PW, Eddy B, Gibbs S, Goh C, Gujral S, Heath C, Henderson A, Jaganathan R, Jakobsen H, James ND, Kanaga Sundaram S, Lees K, Lester J, Lindberg H, Money-Kyrle J, Morris S, O'Sullivan J, Ostler P, Owen L, Patel P, Pope A, Popert R, Raman R, Røder MA, Sayers I, Simms M, Wilson J, Zarkar A, Parmar MKB, Sydes MR.Parker CC, et al. Lancet. 2020 Oct 31;396(10260):1413-1421. doi: 10.1016/S0140-6736(20)31553-1. Epub 2020 Sep 28.Lancet. 2020. PMID: 33002429
- Adjuvant radiotherapy versus early salvage radiotherapy plus short-term androgen deprivation therapy in men with localised prostate cancer after radical prostatectomy (GETUG-AFU 17): a randomised, phase 3 trial. Sargos P, Chabaud S, Latorzeff I, Magné N, Benyoucef A, Supiot S, Pasquier D, Abdiche MS, Gilliot O, Graff-Cailleaud P, Silva M, Bergerot P, Baumann P, Belkacemi Y, Azria D, Brihoum M, Soulié M, Richaud P.Sargos P, et al. Lancet Oncol. 2020 Oct;21(10):1341-1352. doi: 10.1016/S1470-2045(20)30454-X.Lancet Oncol. 2020. PMID: 33002438 Clinical Trial
[post_title] => Radiothérapie après chirurgie : quand ? Pour qui ?
[post_excerpt] =>
[post_status] => publish
[comment_status] => open
[ping_status] => open
[post_password] =>
[post_name] => radiotherapie-apres-chirurgie-quand-pour-qui
[to_ping] =>
[pinged] =>
[post_modified] => 2021-03-11 00:00:00
[post_modified_gmt] => 2021-03-10 23:00:00
[post_content_filtered] =>
[post_parent] => 0
[guid] => https://www.urofrance.org/2021/03/11/radiotherapie-apres-chirurgie-quand-pour-qui/
[menu_order] => 0
[post_type] => post
[post_mime_type] =>
[comment_count] => 0
[filter] => raw
)
[9] => WP_Post Object
(
[ID] => 78873
[post_author] => 1
[post_date] => 2021-03-05 00:00:00
[post_date_gmt] => 2021-03-04 23:00:00
[post_content] =>
La télémédecine ou e-santé ouvre de nouvelles possibilités dans la prise en charge des patients. Outre l'aide au diagnostic, les solutions numériques de santé permettent de déployer un ensemble de pratiques pour améliorer la coordination des soignants et les modalités de le suivi. Le Pr Alain Ruffion, administrateur de l'AFU prend l'exemple des outils mis en place aux Hospices Civils de Lyon (HCL).
Dossier patient informatisé : MyHCL et Easily
« MyHCL est un service en ligne gratuit et sécurisé proposé aux patients des HCL pour faciliter leur suivi médical et leurs formalités administratives ». En concertation avec les praticiens, la direction du système d'information et de l'informatique des HCL a mis en place le portail MyHCL. Grâce à une connexion Internet sécurisée, MyHCL permet aux patients de préparer leur hospitalisation, d'accompagner et de sécuriser le retour à leur domicile. Les parcours de soins sont intégrés et les patients peuvent alimenter un télésuivi. En plus d'être un élément structurant fort, MyHCL met le patient au cur de sa prise en charge et favorise le lien entre l'hôpital et la médecine de ville. Ainsi le patient peut recevoir dans son espace personnel MyHCL des rappels en cas de rendez-vous à prendre, des démarches à effectuer ou des formulaires à remplir. Il peut transmettre aux soignants de l'unité de soins, ses symptômes, ses résultats d'examen, des questions ou des photos utiles dans le cadre de votre suivi.
Côté soignants, cette solution numérique permet de quantifier et de valoriser le temps médical. « Intégrée à la suite logicielle « Easily » (utilisée par les professionnels de santé du CHU), MyHCL est une solution centrée sur le patient et destinée à gagner du temps et du confort dans la prise en charge médicale », explique le Pr Ruffion. Véritable dossier patient informatisé (DPI) Easily, peut par exemple, offrir un chemin clinique au patient dont les étapes sont clairement décrites. « Lorsqu'un patient vient pour une intervention, il est en possession d'une suite de rendez-vous fixés avec les dates de consultation, les rendez-vous pré et post opératoires, les dates de consultation de résultats et la première évaluation fonctionnelle. Ainsi, le suivi de l'histoire du patient est intégralement tracé. Nous pouvons, selon les recommandations sur le Plan Personnalisé de Soins projeter le suivi jusqu'à 10 ans », précise le Pr Alain Ruffion. « Nous travaillons à implémenter des informations complémentaires comme la feuille d'information de l'AFU consultable par le patient, une fiche de recommandations de l'AFU destinée au médecin généraliste et enrichir graduellement l'ensemble du dossier ».
Réhabilitation améliorée après chirurgie pour une prise en charge optimale du patient chirurgical
Le pilier de la réhabilitation améliorée après chirurgie (RAC) est de disposer d'un outil d'évaluation et d'un espace d'échange précis avec le patient. La RAC permet une prise en charge multidisciplinaire et standardisée. Elle permet de diminuer significativement les complications postopératoires, avec pour conséquence une diminution de la durée d'hospitalisation et des coûts de la santé. Le patient est rendu plus vite autonome, ce qui diminue la charge de travail des équipes de soins et permet une sortie plus rapide de l'hôpital sans occasionner de surcharge du secteur ambulatoire. Une prise en charge RAC peut être appliquée à tous les patients, en adaptant individuellement certains de ces éléments. Le médecin traitant joue un rôle essentiel dans cette prise en charge en assurant la continuité de l'information et du suivi du patient. « Le patient mieux informé dispose d'un réseau de suivi avec lequel communiquer. Dès lors, nous constatons une diminution des complications postopératoires, associée à une réduction de la durée d'hospitalisation. Les séjours sont plus courts, voire ambulatoires », précise le Pr Ruffion.
De plus, dans le cas d'une prise en charge RAC, l'investissement en temps des personnels soignants est réduit grâce à la plus grande autonomie du patient. « Nous observons une diminution du temps moyen de soins par jour, et cela permet aux soignants de se concentrer sur les patients qui en ont le plus besoin. C'est une démarche efficace en ce qui concerne la réduction des complications, mais également financièrement pour l'assurance maladie, même si elle n'est pas aujourd'hui valorisée de façon claire », ajoute le Pr Ruffion.
L'audit des pratiques, méthode d'évaluation des pratiques professionnelles
À partir de la solution numérique de santé, les personnels soignants peuvent consulter la synthèse des opérations et modifier ou ajouter une étape au parcours de soin afin qu'il soit plus lisible pour le patient. En fonction des résultats d'une première évaluation des pratiques, les professionnels mettent en place des actions d'amélioration de la qualité des soins. L'impact de ces actions est évalué par une nouvelle mesure des écarts entre la pratique réelle observée et la pratique attendue ou recommandée selon les mêmes critères d'évaluation. « Cela permet de standardiser la pratique, de sécuriser le parcours, et d'effectuer le suivi. De plus, le traitement des audits des pratiques permettra à terme de disposer des résultats des équipes, comme c'est le cas au Royaume-Uni par exemple. Cela permet à chaque équipe de comparer ses pratiques à l'ensemble et d'évaluer ses progrès. C'est une véritable démarche d'intelligence collective et d'optimisation des parcours », ajoute le Pr Alain Ruffion.
[post_title] => Télémédecine : les solutions pour le suivi des patients
[post_excerpt] =>
[post_status] => publish
[comment_status] => open
[ping_status] => open
[post_password] =>
[post_name] => telemedecine-les-solutions-pour-le-suivi-des-patients
[to_ping] =>
[pinged] =>
[post_modified] => 2021-03-05 00:00:00
[post_modified_gmt] => 2021-03-04 23:00:00
[post_content_filtered] =>
[post_parent] => 0
[guid] => https://www.urofrance.org/2021/03/05/telemedecine-les-solutions-pour-le-suivi-des-patients/
[menu_order] => 0
[post_type] => post
[post_mime_type] =>
[comment_count] => 0
[filter] => raw
)
[10] => WP_Post Object
(
[ID] => 79053
[post_author] => 1
[post_date] => 2021-02-08 00:00:00
[post_date_gmt] => 2021-02-07 23:00:00
[post_content] =>
Chères et chers confrères,
L'approvisionnement en BCG de la France métropolitaine ne repose plus, depuis novembre 2020, que sur la production de l'usine affiliée à MEDAC et basée aux Pays-Bas. Afin, à terme, de sécuriser et accroitre sa production de BCG, cette usine entre dans une phase de travaux et cela va impacter l'approvisionnement de tous les pays utilisant le MEDAC.
Toutes les mesures possibles sont prises par l'ANSM et l'AFU avec MEDAC pour mettre en place un approvisionnement alternatif en BCG utilisable pour les instillations endovésicales.
Toutefois, le contingentement nominatif des lots de BCG s'impose dès le 1er février 2021 et vous trouverez sur le site Urofrance.org, dès lundi, les liens pour télécharger les fiches que votre pharmacien devra fournir à MEDAC pour être livré.
Il s'agit de la même procédure que celle mise en place en fin d'année 2019 dont l'efficacité a été démontrée par l'absence de cas rapporté de cystectomie imposée par manque de BCG.
Nous espérons donc, grâce à ces mesures, assurer un approvisionnement dans les meilleures conditions possibles à tous les patients. Au fur et à mesure de l'évolution de la situation, l'Association Française d'Urologie vous tiendra informés.
Bien sincèrement,
Yann NEUZILLET,
Responsable du sous-comité Vessie du CCAFU et Secrétaire Général Adjoint de l'AFU.
[post_title] => Tensions approvisionnement BCG - Février 2021
[post_excerpt] =>
[post_status] => publish
[comment_status] => open
[ping_status] => open
[post_password] =>
[post_name] => tensions-approvisionnement-bcg-fevrier-2021
[to_ping] =>
[pinged] =>
[post_modified] => 2021-02-08 00:00:00
[post_modified_gmt] => 2021-02-07 23:00:00
[post_content_filtered] =>
[post_parent] => 0
[guid] => https://www.urofrance.org/2021/02/08/tensions-approvisionnement-bcg-fevrier-2021/
[menu_order] => 0
[post_type] => post
[post_mime_type] =>
[comment_count] => 0
[filter] => raw
)
[11] => WP_Post Object
(
[ID] => 78874
[post_author] => 1
[post_date] => 2021-02-08 00:00:00
[post_date_gmt] => 2021-02-07 23:00:00
[post_content] =>
Les pouvoirs publics ont produit une série de mesures législatives encadrant l'implantation de bandelettes prothétiques sous urétrale (BSU), afin d'assurer la sécurité des patients. Le point avec le Pr Xavier Gamé, Secrétaire général de l'AFU.
Les bandelettes sous urétrales, pourquoi, comment ?
Les BSU peuvent être proposées pour le traitement des fuites urinaires survenant lors de l'effort chez les femmes pour qui les séances de kinésithérapie de rééducation n'ont pas permis de bénéfice.
Lorsqu'une indication chirurgicale est posée, deux techniques sont actuellement disponibles et peuvent être proposées.
En revanche, les bandelettes dites ajustables ont été retirées du marché. Ces dispositifs « plus courts », rappelle le Pr Gamé, sont dorénavant interdits en France par manque d'études suffisamment puissantes pour garantir leur sécurité et leur performance. Des études complémentaires devront donc être réalisées pour permettre leur retour sur le marché.
Les points clef des décrets
Les modifications de la législation portent sur différents points concernant le chirurgien et la gestion du dossier patient.
Ainsi les patientes devront bénéficier d'un délai légal de réflexion, « par habitude en jurisprudence on parle de deux semaines, mais aucun délai n'a été fixé dans le décret », précise le Pr Gamé.
Leur dossier devra obligatoirement être validé lors de réunions faisant intervenir un gynécologue, un urologue et, éventuellement, un médecin physique et réadaptation spécialisé.
Au décours de sa prise en charge, la patiente devra recevoir un certain nombre de documents d'informations comprenant :
- Le compte rendu de la réunion pluridisciplinaire
- Une fiche d'information sur l'intervention et ses risques (disponible sur le site de l'AFU),
- Une fiche législative rappelant tous les décrets disponibles
- Un document de traçabilité devant indiquer la marque et la référence du matériel implanté
De plus le chirurgien devra justifier d'une expérience chirurgicale, d'une pratique régulière et revoir les patientes dans le mois suivant l'intervention.
Quel avenir pour les bandelettes sous urétrales ?
Ces évolutions dans la législation des BSU ont démarré avec l'arrêté de février 2019 qui a renforcé le contrôle des dispositifs implantables en imposant la réalisation d'études d'efficacité et de sécurité des matériaux. « Et c'est une excellente chose ! », commente le Pr Gamé. En effet, jusqu'alors il suffisait de disposer d'un marquage CE, marquage certifiant uniquement la fabrication et non l'innocuité du produit.
[post_title] => Règlementation des bandelettes sous urétrales pour la sécurité des patientes
[post_excerpt] =>
[post_status] => publish
[comment_status] => open
[ping_status] => open
[post_password] =>
[post_name] => reglementation-des-bandelettes-sous-uretrales-pour-la-securite-des-patientes
[to_ping] =>
[pinged] =>
[post_modified] => 2021-02-08 00:00:00
[post_modified_gmt] => 2021-02-07 23:00:00
[post_content_filtered] =>
[post_parent] => 0
[guid] => https://www.urofrance.org/2021/02/08/reglementation-des-bandelettes-sous-uretrales-pour-la-securite-des-patientes/
[menu_order] => 0
[post_type] => post
[post_mime_type] =>
[comment_count] => 0
[filter] => raw
)
[12] => WP_Post Object
(
[ID] => 20460
[post_author] => 1
[post_date] => 2020-09-18 00:00:00
[post_date_gmt] => 2020-09-17 22:00:00
[post_content] =>
Dès le début du confinement, le Comité Lithiase de l'Association Française d'Urologie (CLAFU) a élaboré des recommandations de prise en charge des calculs urinaires pendant cette pandémie. Le point avec le docteur Christophe Alméras, responsable CLAFU.
Les directives nationales ne s'adaptaient pas à toutes les situations. Pour cette raison, l'AFU et ces membres ont décidé d'établir et de rédiger des recommandations spécifiques pour la prise en charge les calculs rénaux ou urinaires. C'était une première, car aucune société savante avant cela n'avait rédigé de recommandations au cours d'une crise sanitaire au niveau national.
Il faut dire qu'en France, 1 à 2 % des motifs de consultations aux urgences sont liés aux calculs urinaires, autrement nommés lithiases urinaires. Les calculs rénaux sont des petites pierres ou cristaux qui se forment dans l'appareil urinaire, au niveau du rein, parfois de la vessie. Si un calcul se coince dans le tuyau conduisant l'urine du rein à la vessie (uretère), il déclenche une crise de colique néphrétique. Il existe plusieurs sortes de calculs rénaux. Ils sont principalement de nature calcique dans 80 % des cas, à base d'oxalate de calcium. La formation des cristaux d'oxalate de calcium peut résulter de la combinaison de plusieurs facteurs, dont une diminution du volume urinaire ou encore une alimentation riche en oxalates (choux, rhubarbe, épinards, fruits tropicaux, etc.) ou en calcium (produits laitiers). Les calculs rénaux peuvent aussi être composés d'acide urique (dans 10 % des cas).
Le Dr Alméras nous explique les contraintes liées à la crise sanitaire et à la prise en charge des personnes souffrant de calculs urinaires.
« Il était nécessaire d'une part, d'éviter des situations de complications infectieuses, et d'autre part, d'empêcher que les patients encombrent les urgences et encourent un risque de contamination.» Il fallait limiter la fréquentation des urgences par les patients souffrant de lithiase urinaire. Le Dr Alméras précise
« Afin de gérer en priorité les patients en situation d'urgences liées aux calculs urinaires, c'est-à-dire avec un terrain fragilisé et un contexte infectieux, nous devions prévenir les risques de complications infectieuses graves notamment dans le cas de retard de prise en charge. Ces contraintes nous ont amenés à prévoir trois catégories de situations : les urgences, les patients à programmer sous quinze jours et les interventions différées et à surveiller. » Une attention particulière devait être apportée aux patients porteurs de sondes urinaires. En effet ils éliminent beaucoup de cristaux et la sonde peut être rapidement bouchée. Pour ces derniers, il fallait d'une part, traiter la douleur et d'autre part, éviter de les faire revenir aux urgences. Ainsi, les situations les moins urgentes étaient suivies en téléconsultation.
Notons enfin que
ces recommandations sont une véritable source de références documentaires qui pourra servir à l'élaboration d'autres protocoles de soin si la crise sanitaire perdure. Ainsi l'ensemble des sociétés savantes ont publié des recommandations, notamment en cancérologie, chirurgie viscérale, neurochirurgie, greffes rénales, et en hépato-gastro-entérologie (liste non exhaustive).
Pour en savoir plus sur les calculs urinaires, merci de vous rendre sur notre page dédiée aux
« questions-réponses sur la lithiase urinaire ».
[post_title] => Prise en charge des calculs urinaires pendant la crise sanitaire Covid19
[post_excerpt] =>
[post_status] => publish
[comment_status] => open
[ping_status] => open
[post_password] =>
[post_name] => prise-en-charge-des-calculs-urinaires-pendant-la-crise-sanitaire-covid19
[to_ping] =>
[pinged] =>
[post_modified] => 2021-09-07 12:22:35
[post_modified_gmt] => 2021-09-07 10:22:35
[post_content_filtered] =>
[post_parent] => 0
[guid] => https://www.urofrance.org/2020/09/18/prise-en-charge-des-calculs-urinaires-pendant-la-crise-sanitaire-covid19/
[menu_order] => 0
[post_type] => post
[post_mime_type] =>
[comment_count] => 0
[filter] => raw
)
)
[post_count] => 13
[current_post] => -1
[before_loop] => 1
[in_the_loop] =>
[post] => WP_Post Object
(
[ID] => 84081
[post_author] => 6350
[post_date] => 2021-11-20 12:20:15
[post_date_gmt] => 2021-11-20 11:20:15
[post_content] =>
Les recommandations du comité de cancérologie de l’AFU sur la prise en charge des effets indésirables de la BCG-thérapie pour le traitement des tumeurs de la vessie ont presque 10 ans. Faut-il les actualiser ? L’amélioration des connaissances sur les antibiothérapies à BCG semble inviter au repositionnement des stratégies en infectiologie.
La BCG-thérapie pour le traitement des tumeurs vésicales est aussi efficace qu’elle peut se révéler toxique, avec son lot d’effets indésirables plus ou moins graves. Selon la littérature, seuls 16 % des patients tolèrent le schéma thérapeutique complet préconisé par Laam : 6 doses d’induction puis 3 doses à 3 mois, à 6 mois, à 1 an et tous les 6 mois jusqu’à 36 mois. Réduire la durée de la cure ou les doses pour essayer d’améliorer la tolérance conduit à une baisse d’efficacité du traitement. Seule approche possible pour contrôler la toxicité, prendre en charge le plus précocement possible les effets indésirables. Quels sont ces effets ?
Les principales complications
Deux grands types de complications existent. Les premières, locales, prennent la forme d’une infection urinaire à BCG avec syndrome irritatif de la vessie, d’une pollakiurie, d’une infection des testicules, de la présence de sang dans les urines, de brûlures à la miction… Fréquentes, elles n’ont pas de caractère de gravité. Les secondes sont d’ordre systémique. Plus rares mais plus graves pour certaines, elles se traduisent par de la fièvre, de l’arthrite, une ulcération des organes géniaux externes, une prostatite aigüe… voire par l’atteinte d’autres organes : les poumons avec miliaire tuberculeuse, le foie, les os, les reins, le cœur, etc. « Très graves mais peu fréquentes, ces atteintes d’organes mettent en jeu le pronostic vital et imposent l’arrêt définitif du traitement », souligne Fabien Saint. « Trois hypothèses physiopathologiques peuvent expliquer ces complications, poursuit-il : une dissémination du BCG, une hypersensibilité locale, la réactivation de mycobactéries dormantes ».
Des effets indésirables difficiles à éviter
Comment prévenir les effets indésirables d’une BCG-thérapie ? Yann Neuzillet rappelle les situations incompatibles avec la cure, notamment la présence d’une cystite active ou une immunosuppression. Concernant la prévention des effets indésirables peu sévères, l’étude de Marc Colombel préconise la dispensation de fluoroquinolones per-os 6 heures puis 18 heures après l’instillation de BCG. Si ce protocole atténue les effets indésirables, « il ne réduit pas leur inconfort, ce qui amène souvent les patients à demander l’arrêt de la cure », souligne Yann Neuzillet. Autre obstacle, l’efficacité des fluroquinolones est contrebalancée par une sélection des germes résistants (staphylocoque doré multirésistant…).
Que faire face à ces complications ? « Concernant les infections locales, il faut discuter de la suspension temporaire des instillations de BCG », indique Fabien Saint. Pour les complications les plus graves, il attire l’attention sur la typicité des symptômes : de la fièvre et une altération rapide de l’état général. « Il faut savoir penser aux effets d’une BCG-thérapie, même à distance d’une instillation », préconise-t-il. Une réponse thérapeutique rapide est indispensable.
Pierre Derrouch
|
Pénurie du BCG, l’AFU en première ligne
Début 2021, le principal fournisseur de BCG pour la France a annoncé l’arrêt de chaînes de production d’un sous-traitant pour des travaux d’amélioration. Pour anticiper une pénurie transitoire, « un contingentement des approvisionnements basé sur les recommandations de l’AFU et validé par l’ANSM, complété par le recours à une souche danoise ensuite, a permis de répondre aux attentes des patients », rapporte Yann Neuzillet. De quoi couvrir les besoins mensuels de BCG en France évalués à 9 500 doses en moyenne.
|
Crédit photo : © Shidlovski
[post_title] => Tumeurs de la vessie, de la bonne gestion des effets indésirables de la BCG-thérapie
[post_excerpt] =>
[post_status] => publish
[comment_status] => open
[ping_status] => open
[post_password] =>
[post_name] => tumeurs-de-la-vessie-de-la-bonne-gestion-des-effets-indesirables-de-la-bcg-therapie
[to_ping] =>
[pinged] =>
[post_modified] => 2022-04-25 17:53:15
[post_modified_gmt] => 2022-04-25 15:53:15
[post_content_filtered] =>
[post_parent] => 0
[guid] => https://www.urofrance.org/?p=84081
[menu_order] => 0
[post_type] => post
[post_mime_type] =>
[comment_count] => 0
[filter] => raw
)
[comment_count] => 0
[current_comment] => -1
[found_posts] => 172
[max_num_pages] => 14
[max_num_comment_pages] => 0
[is_single] =>
[is_preview] =>
[is_page] =>
[is_archive] => 1
[is_date] =>
[is_year] =>
[is_month] =>
[is_day] =>
[is_time] =>
[is_author] =>
[is_category] => 1
[is_tag] =>
[is_tax] =>
[is_search] =>
[is_feed] =>
[is_comment_feed] =>
[is_trackback] =>
[is_home] =>
[is_privacy_policy] =>
[is_404] =>
[is_embed] =>
[is_paged] => 1
[is_admin] =>
[is_attachment] =>
[is_singular] =>
[is_robots] =>
[is_favicon] =>
[is_posts_page] =>
[is_post_type_archive] =>
[query_vars_hash:WP_Query:private] => e145f21ab7d0e7963ab689104c8b7163
[query_vars_changed:WP_Query:private] =>
[thumbnails_cached] =>
[allow_query_attachment_by_filename:protected] =>
[stopwords:WP_Query:private] =>
[compat_fields:WP_Query:private] => Array
(
[0] => query_vars_hash
[1] => query_vars_changed
)
[compat_methods:WP_Query:private] => Array
(
[0] => init_query_flags
[1] => parse_tax_query
)
)