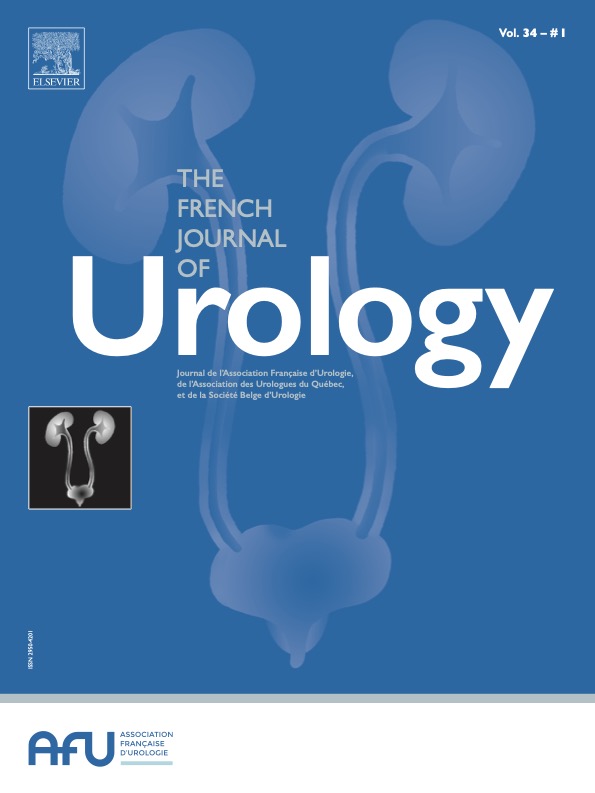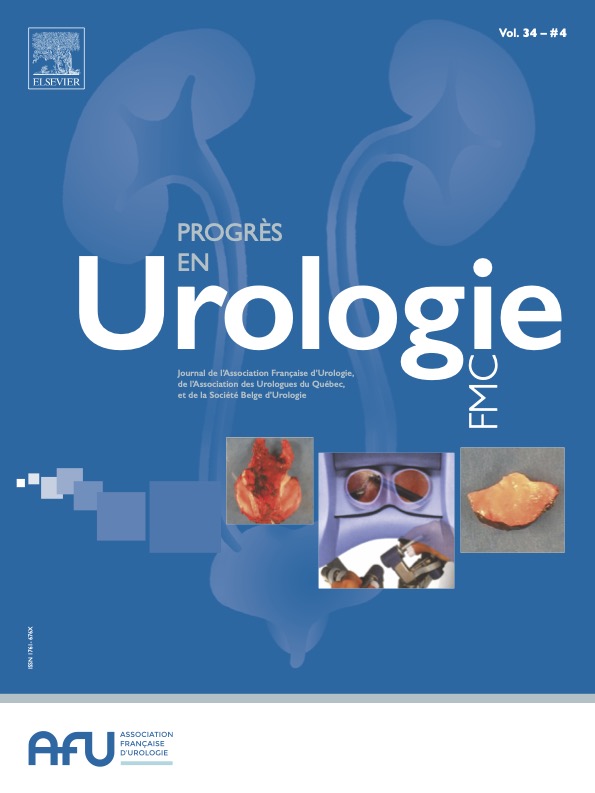Chapitre 05 – Sexualité normale et ses troubles
Item 56 – UE 3
Auteurs : Idir Ouzaid, François Giuliano |
Relecture : Morgan Rouprêt |
Plan |
Objectifs pédagogiques
|
Résumé
Une sexualité normale comprend plusieurs phases :
- désir ;
- excitation ;
- plateaux (coït) ;
- orgasme concomitant chez l’homme de l’éjaculation ;
- résolution.
Les dysfonctions sexuelles peuvent intéresser chacune de ces phases. On distingue ainsi :
- troubles par excès :
- satyriasis, nymphomanie,
- voire éjaculation prématurée ;
- troubles par défaut :
- anaphrodisie,
- anorgasmie,
- vaginisme,
- dyspareunie.
La paraphilie est une sexualité atypique ou marginale. Elle est source de souffrance. La différence avec une sexualité traditionnelle peut être liée à :
- l’objet (autour de l’objet sexuel recherché) :
- humain : inceste, pédophilie, gérontophilie, nécrophilie,
- non humain : fétichisme, zoophilie
- l’objectif (le but recherché) :
- plaisir de la vue : exhibitionnisme, voyeurisme,
- plaisir de la souffrance : sadisme, masochisme,
- plaisir localisé : bouche, urètre, anus.
Le transsexualisme est un trouble de l’identité sexuelle. Il pose des problèmes sociétaux et légaux (état civil).
Les principes de la prise en charge des troubles sexuels :
- parfois pluridisciplinaire ;
- toujours la nécessité d’une évaluation de la souffrance qui fait souvent partie de la définition (éjaculation prématurée, dysfonctions sexuelles féminines) ; identification des troubles (critères DSM-IV) ;
- la prise en charge psycho-sexologique (techniques cognitivo-comportementales, parfois analytique) peut être proposée en première intention ;
- les approches pharmacologiques sont pertinentes pour l’éjaculation prématurée, dans certains troubles du désir (hypo- et hyper-) ;
- toujours évoquer une iatrogénie médicamenteuse, chirurgicale, séquelles de radiothérapie pelvienne ;
- certains troubles sexuels sont des facteurs de risque de délits ou crimes sexuels ;
- les souffrances engendrées peuvent être à l’origine d’autres troubles psychiatriques : dépression, passage à l’acte, conduites à risque.
I – Pour comprendre
La sexualité est, du point de vue de la perpétuation de l’espèce, orientée vers la procréation. Néanmoins, elle a toujours eu des significations autres : pouvoir, valeur, place sociale de l’individu
L’apparition de moyens efficaces de contraception et la légalisation de l’avortement ont apparemment affranchi la sexualité de sa liaison avec la grossesse et ont favorisé une libération certaine des murs, de même qu’un changement dans le statut et les rôles sociaux des femmes et des hommes depuis quelques décennies. La possibilité de contamination par le VIH pèse sur les pratiques sexuelles et doit faire l’objet de prévention de chacun, en particulier des médecins.
La sexualité dite « normale » fait partie de la définition de la « bonne santé » selon l’OMS. On parle désormais de « santé sexuelle ». Même s’il n’est pas possible de définir une sexualité normale, une dysfonction de l’une des réponses sexuelles physiologiques à l’excitation : désir, érection, éjaculation, orgasme expose l’individu à des souffrances parfois importantes, parfois causes de dépression. Les troubles du comportement sexuel peuvent être responsables de conduites délictueuses, voire de crimes sexuels (sévices à enfants, viols, agressions sexuelles ).
La compréhension et la prise en charge diagnostique et thérapeutique des dysfonctions sexuelles font partie intégrante de la pratique médicale. Le soulagement de la souffrance des patients ainsi que la restauration d’une sexualité satisfaisante sont les objectifs à atteindre.
II – Introduction
Il n’y a pas de norme en matière de sexualité. Chaque individu a ses propres repères et sa position dans la société peut influencer le développement et ou le déroulement de sa sexualité selon ce que l’on pourrait appeler le plus petit dénominateur commun de ce qui est toléré, de ses références culturelles et religieuses.
- Lorsqu’il existe une dysfonction sexuelle, s’il n’y a pas de plainte de l’individu il n’y a pas lieu de médicaliser celle-ci.
- De même, lorsqu’il existe un trouble du comportement sexuel et qu’il n’y a pas de plainte (de l’individu, de son entourage ou de la société), il n’y a pas lieu de proposer un traitement.
La version actuelle du Diagnostic and Statistical manual of Mental Disorders (DSMV), ou Manuel diagnostique et statistique des maladies mentales de la société américaine de psychiatrie, distingue : les dysfonctions sexuelles (troubles du désir, de l’excitation ou de l’orgasme ; les troubles sexuels avec douleur ; la dysfonction sexuelle due à une affection médicale générale), les paraphilies, les troubles de l’identité sexuelle (transsexualisme).
III – Sexualité normale
La connaissance de la physiologie de la sexualité a bénéficié des travaux de William Masters et Virginia Johnson, sexologues nord-américains s’appuyant sur les observations de leurs patients hommes et femmes, ainsi que leur méthode de traitement des difficultés sexuelles.
L’activité sexuelle est divisée en cinq phases (fig. 5.1) :
- la phase du désir : elle est caractérisée par des idées et fantasmes érotiques et le souhait d’avoir des rapports sexuels. Elle est difficile à définir précisément dans sa durée comme dans sa phénoménologie. Cette phase est commandée par le cerveau. Le désir est androgéno-dépendant chez l’homme comme chez la femme. Il s’agit d’une phase de préparation à l’acte sexuel ;
- la phase d’excitation : elle est caractérisée chez l’homme par l’érection (cf. chapitre 9 : [item 122 – Trouble de l’érection]), et chez la femme par une augmentation de la vascularisation vaginale et de la vulve se traduisant par la lubrification vaginale[1] et l’érection du clitoris. La phase d’excitation résulte de stimulations cérébrales (visuelles, auditives, fantasmatiques) et/ou périphériques en particulier périnéales. La survenue des réponses sexuelles pelvi-périnéales nécessite l’intégrité de l’innervation sympathique d’origine spinale thoraco-lombaire (T12-L2), parasympathique d’origine spinale sacrée (S2-S4) et somatique sacrée (S2-S4) ;
- la phase de plateau : elle consiste en la réalisation du coït ou la poursuite de la stimulation (ex. : masturbation). Les phénomènes de la phase d’excitation y restent stables, au maximum de leur développement ;
- l’orgasme : il s’agit d’une sensation de plaisir intense[2]. L’orgasme est accompagné dans les deux sexes de contractions rythmiques de la musculature striée périnéale. Chez l’homme, l’orgasme coïncide avec la seconde phase de l’éjaculation ou expulsion saccadée du sperme au méat urétral. Lorsque l’éjaculation est absente (ex. : après prostatectomie totale), l’orgasme persiste, ainsi l’éjaculation n’est pas un prérequis pour la survenue de l’orgasme. L’orgasme est accompagnépar des signes généraux : tension musculaire, polypnée, tachycardie, augmentation de la pression artérielle ; il faut souligner ici que plus d’un tiers des femmes rapportent ne pas avoir d’orgasme ;
- la phase de résolution : les phénomènes caractéristiques de la phase d’excitation diminuent rapidement. La femme peut avoir plusieurs orgasmes successifs si la stimulation sexuelle ne s’interrompt pas, et la phase de résolution ne survient alors qu’après le dernier orgasme (fig. 5.1). Chez l’homme, l’orgasme est suivi d’une période réfractaire pendant laquelle la stimulation sexuelle est inefficace. Brève chez l’adolescent, elle augmente avec l’âge et interdit le plus souvent la répétition rapprochée du rapport sexuel chez l’homme vieillissant.
 |
- La lubrification vaginale est en rapport avec un transsudat vasculaire et non une sécrétion glandulaire.
- L’orgasme clitoridien, déclenché par la stimulation du clitoris, et l’orgasme vaginal, déclenché par la stimulation intravaginale, sont physiologiquement identiques. L’orgasme vaginal peut être plus difficile à obtenir sans que cela soit pathologique.
IV – Troubles de la sexualité
A – Troubles sexuels chez l’homme
1 – Troubles du désir
a – Insuffisance du désir ou baisse de la libido
Face à ces symptômes, il faut envisager les étiologies suivantes :
- une dépression masquée ;
- une iatrogénie médicamenteuse avec notamment la prise d’antidépresseurs inhibiteurs sélectifs de recapture de la sérotonine et neuroleptiques, agonistes de la LH-RH et anti-androgènes chez l’homme ;
- un déficit androgénique, en particulier le déficit androgénique lié à l’âge[1] ;
- des facteurs psychosociaux : stress professionnel, personnel ;
- toujours éliminer une maladie somatique chronique sous-jacente (ex. : diabète insulinodépendant, sclérose en plaques ).
b – Excès et/ou déviation du désir
Dans ce contexte, les aspects suivants sont à prendre en compte :
- une exagération des besoins sexuels (satyriasis) ;
- un risque de délinquance sexuelle ;
- savoir éliminer une organicité (syndrome frontal post-AVC ou traumatisme crânien sévère, maladie de Parkinson traitée par agonistes dopaminergiques).
- la privation androgénique pharmacologique peut-être indiquée.
2 – Troubles de l’excitation/érection
Cf. chapitre 9 (Item 122 – Trouble de l’érection).
3 – Troubles de l’éjaculation
a – Éjaculation prématurée
Définition
Il s’agit d’une dysfonction sexuelle masculine caractérisée par :
- une éjaculation qui survient toujours ou presque toujours en 1 minute ou moins après la pénétration vaginale depuis le 1er rapport sexuel (éjaculation prématurée primaire) ;
- ou une diminution cliniquement significative du délai pour éjaculer, souvent proche de 3 minutes ou moins (éjaculation prématurée secondaire) ;
- et une incapacité à retarder l’éjaculation lors de toutes ou de presque toutes les pénétrations vaginales ;
- et des conséquences personnelles négatives : souffrance, gêne, frustration et/ou évitement de l’intimité sexuelle (fig. 5.2).
 |
Étiologies
L’éjaculation est un réflexe de reproduction et survient chez la plupart des espèces de façon précoce. L’homme a la capacité de pouvoir contrôler son éjaculation, ce qui explique que l’éjaculation prématurée est une caractéristique comportementale. Il ne s’agit donc pas d’une dysfonction au sens physiopathologique du terme. La prévalence n’est pas affectée par l’âge, contrairement à la dysfonction érectile.
Diagnostic
L’interrogatoire doit explorer notamment : le délai pour éjaculer et la possibilité ou non de contrôle ainsi que la souffrance que cette situation génère. L’examen clinique doit rechercher une éventuelle pathologie génito-sexuelle associée, ainsi qu’unedysfonction érectile (éjaculation prématurée acquise). Aucun examen complémentaire n’est requis.
Traitement
Le traitement peut faire appel à une prise en charge sexologique de type cognitivo-comportemental : techniques du squeeze ou du « Stop and Go », nécessitant la participation de la partenaire, les rechutes sont fréquentes en cas d’arrêt des exercices. La dapoxétine (30 ou 60 mg, Priligy®) à la demande, inhibiteur sélectif de recapture de la sérotonine, est le médicament ayant l’AMM dans cette indication. Les antidépresseurs en prise quotidienne (ISRS, ex. : paroxétine 20 mg/j ou clomipramine 10 mg/j) peuvent être prescrits hors AMM. Les anesthésiques locaux (lidocaïne crème 5 %) hors AMM à la demande en application sur le gland 30 à 60 minutes avant le rapport retardent également l’éjaculation.
b – Autres troubles de l’éjaculation
La sémiologie des autres troubles de l’éjaculation nécessite un interrogatoire attentif souvent difficile à conduire.
Il faut savoir distinguer :
- l’anéjaculation/éjaculation rétrograde avec orgasme conservé par iatrogénie chirurgicale en particulier dans les situations suivantes : résection transurétrale de la prostate, adénomectomie par voie haute pour hypertrophie bénigne de prostate, prostatectomie totale pour cancer localisé de prostate, curage ganglionnaire pour cancer du testicule ;
- l’anéjaculation et l’anorgasmie par iatrogénie médicamenteuse (neuroleptiques, certains ?-bloquants indiqués dans le traitement des troubles mictionnels liés à une hypertrophie bénigne de prostate : tamsulosine, silodosine) ou d’origine psychogène ;
- l’éjaculation rétrograde complication de la neuropathie végétative diabétique. Le diagnostic est affirmé par la présence de spermatozoïdes dans les urines après masturbation ;
- l’anorgasmie isolée avec éjaculation conservée du blessé médullaire ;
- l’éjaculation retardée en cas de sclérose en plaques ou iatrogène (ISRS, clomipramine) ou psychogénique ;
- l’hypospermie. C’est un signe d’agénésie des déférents consécutive à une mutation du gène CFTR (mucoviscidose). Le plus souvent elle est liée au vieillissement ;
- l’éjaculation douloureuse peut être la conséquence d’une prostatite aiguë ou chronique ou un syndrome douloureux pelvien chronique ;
- l’hémospermie est le plus souvent un symptôme bénin. Il faut toutefois éliminer un cancer de la prostate chez l’homme vieillissant. Elle est fréquemment observée dans les suites de biopsies de la prostate à visée diagnostique.
B – Troubles sexuels chez la femme[2]
1 – Troubles du désir
Les troubles du désir correspondent le plus souvent à une insuffisance/absence du désir ou à un désir sexuel hypo-actif entraînant une souffrance personnelle.
On distingue les troubles primaires (jamais éprouvés de désir) et secondaires après une période de désir normal (moins bien acceptés).
Les causes peuvent être :
- organiques :
- iatrogénie médicamenteuse : antidépresseurs, neuroleptiques, tamoxifène,
- ménopause chirurgicale ;
- circonstancielles ou psychologiques :
- choc émotionnel,
- dépression,
- omission des préliminaires,
- dysfonction sexuelle du partenaire,
- conjugopathie,
- nudité mal acceptée,
- conditions sociales défavorables de la vie du couple,
- stérilité (rapport sexuel inutile).
Le traitement des troubles du désir est difficile. Il faut notamment s’efforcer de donner des informations sur la sexualité, de faire la démonstration de la normalité physique et physiologique pour rassurer la patiente et assurer la prise en charge psycho-sexologique. Enfin, il est utile de traiter la ménopause si celle-ci est avérée.
a – Aversion sexuelle
Cet état correspond à une conduite visant à éviter d’avoir des rapports sexuels entraînant une souffrance personnelle. La cause est essentiellement psychique. Il faut toutefois veiller à éliminer une névrose phobique.
b – Excès de désir
Il s’agit d’une exagération des besoins sexuels (hypersexualité ou nymphomanie), à la recherche permanente de nouveaux partenaires (comportements de séduction permanente). Il faut savoir mettre à jour une personnalité pathologique de type histrionique ou narcissique. L’excès de désir peut être également une manifestation de troubles psychiatriques comme l’état maniaque ou la psychose. Devant ce syndrome, il faut savoir éliminer un problème organique sous-jacent : neurologique (tumeur frontale ou temporale, épilepsie partielle, syndrome démentiel) ; toxique (intoxication alcoolique aiguë) ; iatrogène (dopaminergiques, antidépresseurs [virage de l’humeur], corticothérapies).
2 – Troubles de l’excitation (insuffisance)
Il s’agit d’un problème en rapport avec le degré d’excitation sexuel organique ou psychique suffisant entraînant une souffrance personnelle.
3 – Troubles de l’orgasme
On distingue les troubles suivants.
a – Anorgasmie
C’est une absence d’orgasme malgré une stimulation et une excitation adéquate entraînant une souffrance personnelle.
b – Orgasme insatisfaisant
c – Orgasme retardé
La stimulation et l’excitation sont jugées excessives par la femme.
Une iatrogénie médicamenteuse (ISRS, neuroleptiques) doit être recherchée.
d – Vaginisme
Il s’agit d’une contraction musculaire prolongée ou récidivante des muscles du plancher pelvien (élévateurs de l’anus et adducteurs) qui circonscrivent la vulve et le vagin interdisant la pénétration vaginale.
Le vaginisme primaire est souvent d’origine psychologique. Il peut avoir comme cause :
- le rigorisme religieux, le conformisme social avec culpabilisation des plaisirs du corps ;
- un antécédent d’abus sexuel : attouchements, viol, inceste ;
- une tendance homosexuelle latente ;
- le rejet du partenaire (symbolise le refus d’une relation vécue comme un état d’infériorité avec un homme que l’on méprise).
Le vaginisme secondaire doit faire rechercher une cause organique par un examen gynécologique complet.
- Traumatisme gynécologique : vaginite mycosique, vaginite à Trichomonas, vaginite atrophique de la ménopause.
- Traumatisme obstétrical : déchirure, épisiotomie mal réparée.
- Traumatisme iatrogène : cobalthérapie.
Le traitement du vaginisme comprend avant tout le traitement spécifique d’une lésion organique. En l’absence de lésion organique, il faut envisager une prise en charge psycho-sexologique avec explication anatomique (appareil génital), exploration de son corps (surmonter l’angoisse), auto-introduction ultérieure par la patiente avec des bougies de Hégar de calibre croissant avec exercice de contraction et de relâchement (relais avec ses propres doigts). Le vaginisme a un bon pronostic quand la femme accepte de faire ce travail personnel sur son corps.
e – Dyspareunie
Elle correspond à des douleurs déclenchées par les relations sexuelles. On distingue trois types de dyspareunie :
- les dyspareunies superficielles ou d’intromission :
- une étroitesse pathologique : une bride hyménéale, une hypoplasie vaginale, une atrophie vaginale avec au maximum un lichen scléro-atrophique,
- une myorraphie trop serrée des releveurs après une cure de prolapsus, l’existence de cicatrices scléreuses du périnée après épisiotomie ou déchirure obstétricale,
- un herpès, un eczéma vulvaire, une fissure anale, une mycose, une bartholinite, des condylomes ;
- les dyspareunies de présence :
- une vaginite avec état inflammatoire important,
- une mycose souvent associée à un prurit vulvaire,
- une atrophie muqueuse (ménopause ou après une ovariectomie),
- une sécheresse pathologique des muqueuses génitales,
- un raccourcissement vaginal postopératoire ;
- les dyspareunies profondes (balistiques ou de choc) de cause toujours organique :
- inflammation pelvienne : cervicite, annexite, cellulite pelvienne,
- endométriose : rechercher les nodules bleutés du fond vaginal au spéculum et des nodules au toucher des ligaments utéro-sacrés.
Le traitement des dyspareunies profondes nécessite souvent une coelioscopie pour faire le diagnostic de la cause, et en particulier rechercher et traiter l’endométriose. Une thérapie cognitivo-comportementale peut être proposée. Les complications sont émaillées par le vaginisme, l’anaphrodisie, l’anorgasmie ou une conjugopathie. Les dyspareunies ont un bon pronostic quand la cause est traitée suffisamment tôt.
f – Douleur génitale
Elles sont sans rapport avec la pénétration, mais ces douleurs sont provoquées par une stimulation non coïtale. Elle génère une interférence avec la vie sexuelle, ce qui est la plupart du temps une source de souffrance.
- Correspondant à l’andropause (cf. chapitre 6 [Item 120 – Andropause]), véritable ménopause chez l’homme.
- Il faut bannir définitivement du vocabulaire sexologique le terme de frigidité. Ce terme est trop galvaudé pour continuer à être utilisé.
V – Paraphilies
A – Définition
La paraphilie (du grec para « auprès de, à côté de » et philia « amour, porter de l’intérêt à ») est un mot apparu au XXe siècle pour décrire des pratiques sexuelles qui diffèrent des actes traditionnellement considérés comme normaux. Communément, la paraphilie est une sexualité atypique ou marginale.
Selon le DSM-IV, ce sont des impulsions sexuelles répétées et intenses, et fantasmes sexuellement excitants ou comportements impliquant : des objets inanimés (fétichisme), l’humiliation ou la souffrance (non simulée) du sujet lui-même ou de son partenaire (sadomasochisme), des enfants ou individus non consentants (pédophilie, exhibitionnisme, voyeurisme, frotteurisme, sadisme, nécrophilie), se prolongeant au moins 6 mois, causant du désarroi ou une détérioration du fonctionnement social, occupationnel ou autre domaine important.
B – Différents types de paraphilies
Selon l’objet (autour de l’objet sexuel recherché) :
- humain : inceste, pédophilie, gérontophilie, nécrophilie ;
- non humain : fétichisme, zoophilie
Selon l’objectif (le but recherché) :
- plaisir de la vue : exhibitionnisme, voyeurisme ;
- plaisir de la souffrance : sadisme, masochisme ;
- plaisir localisé : bouche, urètre, anus.
C – Diagnostic et sévérité
Le rapport homme/femme est de vingt hommes pour une femme. En effet, en dehors du masochisme, peu de femmes souffrent de paraphilies. Le diagnostic se pose seulement lorsque l’individu agit sous l’emprise de ses impulsions ou est fortement perturbé par celles-ci. Les paraphilies interfèrent à divers degrés avec la capacité du sujet à avoir une activité sexuelle empreinte d’affection et de réciprocité (tableau 5.1).
| Gravité | Légère | Moyenne | Sévère |
|---|---|---|---|
| Passage à l’acte | non | oui | oui |
| Fréquence | – | occasionnelle | répétée |
D – Principes de traitement
1 – Approche comportementale
L’objectif est de chercher à éliminer le comportement inadéquat pour le remplacer par un comportement plus adapté. La technique de l’aversion est parfois utilisée via des stimuli aversifs qui peuvent être de nature chimique (vomitifs, nausées) ou électrochocs, imagerie aversive ou honte. La technique d’évitement par anticipation correspond à l’apprentissage d’une sexualité plus adaptée :
- reconditionnement orgastique : lors de la masturbation, le fantasme déviant est associé à l’image hétérosexuelle « normale » au moment de l’orgasme ;
- masturbation à satiété : l’individu doit se masturber tout en imaginant son fantasme déviant jusqu’à satiété.
Critique de l’approche comportementale où seul le symptôme est traité : elle est basée sur le changement de comportement. Or, les émotions doivent aussi changer.
2 – Approche analytique (sexo-analyse)
L’accent est mis sur la compréhension du désordre sexuel. La modification de l’imaginaire érotique implique une expérience correctrice. À moyen terme, l’individu est amené à produire des fantasmes érotiques et à surmonter graduellement les anxiétés qui sont à la base du désordre sexuel.
VI – Transsexualisme
A – Définition
Le DSM-IV classe le transsexualisme dans les troubles de l’identité sexuelle, les caractéristiques diagnostiques sont :
- identification intense et persistante à l’autre sexe[1] ;
- expression d’un désir d’appartenir à l’autre sexe, à l’adoption fréquente des conduites où l’on se fait passer pour l’autre sexe, désir de vivre et d’être traité comme l’autre sexe. Le patient a la conviction qu’il(elle) possède les sentiments et les réactions typiques de l’autre sexe ;
- sentiment persistant d’inconfort par rapport à son sexe ou sentiment d’inadéquation par rapport à l’identité de rôle correspondante. Le patient a la volonté se débarrasser de ses caractères sexuels primaires et secondaires :
- traitement hormonal, intervention chirurgicale,
- tenue vestimentaire.
Le patient pense que le sexe avec lequel il(elle) est né(e) n’est pas le bon.
L’affection n’est pas concomitante d’une affection responsable d’un phénotype hermaphrodite. La souffrance est significative et s’associe à une altération du fonctionnement social, professionnel ou dans d’autres domaines importants. Pour les sujets ayant atteint la maturité sexuelle, il faut s’enquérir de savoir s’ils sont attirés sexuellement par des hommes, les femmes, les deux ou ni par un sexe ni par l’autre.
B – Classification
1 – Transsexualisme primaire
Le sujet s’est toujours senti du sexe opposé depuis le jeune âge, voire même l’enfance.
2 – Transsexualisme secondaire
L’apparition des troubles est plus tardive.[2]
C – Problématiques
Le transsexualisme pose un problème d’état civil (passeport, mariage, héritage, ). La législation est extrêmement variable d’un pays à l’autre. Il faut évaluer précisément la souffrance psychologique du « candidat transsexuel ». Il n’est pas rare de voir de la part du patient des comportements d’automutilation, de passage à l’acte suicidaire ou de dépression. Souvent, le patient souffre de discrimination et d’un sentiment de rejet de la société. La transformation hormono-chirurgicale n’est qu’une solution d’apparence et de portée souvent limitée (les souffrances restent).
D – Principes de la prise en charge
La prise en charge est nécessairement multidisciplinaire incluant : psychiatre, endocrinologue, chirurgien, services sociaux, psychologue. L’évaluation du patient est longue (minimum 2 ans), et au cours de celle-ci aucune décision irréversible n’est prise.
1 – Évaluation psychiatrique
Elle est longue et répétée et doit inclure l’entourage. Elle doit établir un diagnostic précis du trouble de l’identité. Elle recherche une contre-indication à la transformation hormono-chirurgicale : psychopathie (délire, fétichisme, ), visée utilitaire (prostitution).
2 – Évaluation endocrinologique
La recherche clinique et biologique d’une affection susceptible d’entraîner ou de favoriser un trouble de l’identité de genre doit être effectuée (cf. A. Définition). Le bilan doit confirmer l’intégrité du système endocrinien. Il faut évaluer les caractèressexuels secondaires et les organes génitaux externes avant leurs éventuelles modifications ultérieures. Il faut s’efforcer de rechercher des contre-indications à un éventuel traitement hormonal ultérieur (adénome hypophysaire, AVC, diabète non équilibré, HTA sévère, ), sachant qu’après castration ce traitement sera indispensable et définitif.
- Traitement hormonal :
- Homme : anti-androgènes (effets réversibles) puis strogènes (irréversibles ou partiellement réversibles).
- Femme : progestatifs (effets réversibles) puis testostérone (irréversibles ou partiellement réversibles).
3 – Prise en charge médico-sociale
En France, ces patients sont pris en charge à 100 % par la sécurité sociale.
Expérience en vie réelle (real life test) d’une durée de 1 an :
- le sujet se présente comme un sujet de l’autre sexe ;
- ne se limite pas au travestissement ;
- rédaction de certificat médical attestant que « le sujet se présente sous une apparence féminine (ou masculine) pour des raisons exclusivement médicales ».
4 – Bilan psychologique
- Test de niveau (Binois-Pichot) et de personnalité (Rorschach et MMPI).
- Comparaison de l’indice d’anxiété et l’échelle de masculinité-féminité à des profils types masculin ou féminin.
5 – Prise en charge chirurgicale +++
- Constater l’état des organes sexuels.
- Rechercher des anomalies physiques susceptibles de gêner une éventuelle intervention ultérieure (obésité morbide par exemple).
- Éliminer une contre-indication opératoire (troubles de l’hémostase, décompensation d’une séropositivité ).
- Information éclairée du patient, souvent mal renseigné.
- Évaluer la motivation du « candidat transsexuel ».
Transformation chirurgicale
- Homme : castration bilatérale (ablation des testicules, des corps caverneux et spongieux) suivie de la création d’unnéovagin tapissé par la peau pénienne retournée en doigt de gant et de grandes lèvres à partir du scrotum. Il est réalisé unnéoclitoris grâce à un lambeau en îlot neuro-vasculaire taillé au niveau du gland et une urétrostomie périnéale.
- Femme : mammectomie et hystéro-ovariectomie non conservatrice. Elle est éventuellement complétée par unephalloplastie (fig. 5.3). Les résultats sont plus satisfaisants sur le plan morphologique que sur le plan fonctionnel. Il est à noter que la phalloplastie n’est pas exigée pour obtenir le changement d’état civil.
| A. Vue préopératoire. Remarquer la pilosité développée après le traitement hormonal. B. Phalloplastie avec un lambeau pédiculé de l’avant-bras. C. Vue postopératoire immédiate. D. Le résultat à 1 mois de l’intervention. Noter le résultat de la mammoplastie bilatérale pratiquée lors de l’hystérectomie totale avec ovariectomie 6 mois avant la phalloplastie et le développement musculaire androïde. À distance, un implant pénien et des prothèses testiculaires sont posés. Crédit photos : Dr Jonathan Rausky. Service chirurgie plastique et réparatrice, Hôpital Saint-Louis, Paris. |
 |
- Ne concerne pas exclusivement le désir d’obtenir les bénéfices culturels dévolus à l’autre sexe.
- Le sujet a déjà eu des enfants ou une vie conjugale pendant plusieurs années.
Vous pourrez également aimer
Continuer votre lecture
- Chapitre 14 – Hématurie
- Chapitre 12 – Infections sexuellement transmissibles
- Chapitre 13 – Transplantation d’organes
- Chapitre 11 – Infections urinaires de l’enfant et de l’adulte
- Chapitre 09 – Trouble de l’érection
- Chapitre 10 – Hypertrophie bénigne de la prostate
- Chapitre 08 – Troubles de la miction de l’adulte et du sujet âgé
- Chapitre 06 – Andropause