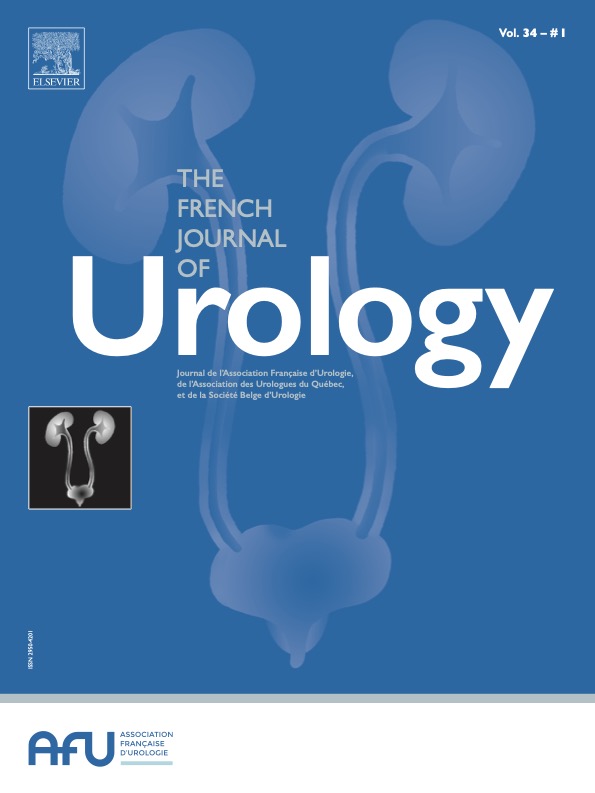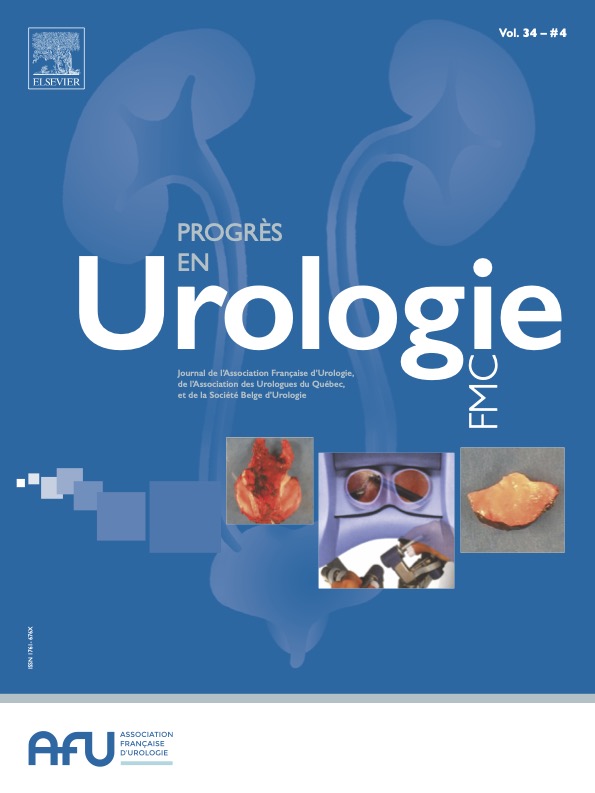Depuis 1995, l’Association française d’urologie, par le biais de son comité de cancérologie (CCAFU), émet des recommandations pour guider et homogénéiser les pratiques au niveau national. Elles synthétisent l’état de l’art en s’appuyant sur une mise à jour régulière des données de la littérature. En 2013, le CCAFU s’apprête à émettre la huitième édition de ses recommandations.
Depuis les années 1970, l’incidence du cancer du rein (RCC) est en augmentation aussi bien en France, en Europe qu’en Amérique du nord [1, 2]. D’un point de vue chirurgical, la prise en charge du RCC a vu émerger la néphrectomie partielle (NP) des tumeurs localisées qui a pour objectifs la préservation néphronique, d’une part, et la réduction de la morbi-mortalité cardiovasculaire inhérente à la néphrectomie totale (NT), d’autre part [3]. Par ailleurs, la voie laparoscopique et robot-assistée est en plein essor [4].
La comparaison du contenu des recommandations de 2007 [5] et de 2010 [6] met en évidence l’évolution du texte vers des traitements moins invasifs. Désormais, la NP doit être considérée pour toutes les tumeurs classées T1 (<7cm) lorsque l’intervention est techniquement faisable (Tableau 1). Par ailleurs, la surrénalectomie ne doit plus être associée systématiquement à une NT. Dans ce contexte, il nous a paru intéressant d’établir un état des lieux de la chirurgie rénale et de vérifier si les pratiques réelles sont en accord avec l’évolution du texte de recommandations.
Notre objectif était d’évaluer les pratiques nationales de la chirurgie rénale deux ans avant et après les recommandations actuelles.
|
| Interrogation de la base de données |
La base de données nationale de l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation (ATIH) a été interrogée [7]. Les codes de la Classification commune des actes médicaux (CCAM) ont été utilisés pour extraire les données nationales relatives à la chirurgie rénale de 2009 à 2012 (Annexe 1). Cette durée d’étude a été divisée en deux périodes : période 1 (2009–2010) et période 2 (2011–2012). Les interventions ont été classées en fonction de leur type, de la voie chirurgicale et du secteur d’activité respectivement en : NP versus NT, voie ouverte versus voie cœlioscopique/cœlioscopique robot-assistée et secteur public versus secteur privé. Le secteur public incluait également les établissements d’hospitalisation de statut privé participant au service public hospitalier (PSPH, désormais dénommés Établissements de santé privés d’intérêt collectif [ESPIC]). Les données ainsi extraites étaient anonymes. Par conséquent, un avis d’un comité d’éthique n’a pas été demandé.
Les deux périodes ont alors été comparées. Par ailleurs, les tendances des types d’interventions et la voie chirurgicale ont été évaluées sur la durée de l’étude.
Les données sont présentées sous formes de valeurs absolues et de proportions. Le nombre d’interventions entre les différentes périodes, secteurs d’activité et les différentes interventions ont été comparés par un test Chi2 d’une façon bilatérale. L’évolution des différents types d’intervention a été évaluée avec une régression linéaire. Le logiciel SSPS version 20.0 (IBM Corp., Armonk, NY, États-Unis) a été utilisé avec un seuil de significativité des tests à 0,05.
Sur la durée de l’étude, 56907 interventions ont été réalisées. Parmi celles-ci, 28000 (public : 14585 ; privé : 13415) et 28907 (public : 15141 ; privé : 13766) ont successivement été déclarées sur les périodes 1 (2009–2010) et 2 (2011–2012), soit une moyenne respective de 14000 et 14450 actes par an. Il n’y avait pas de différence significative entre les secteurs public et privé (p =0,49). Le taux de chirurgie rénale partielle a augmenté de 30 % à 35 % (p <0,0001) entre les deux périodes. Cette évolution était similaire dans les secteurs public et privé (Annexe 2). La proportion de la voie cœlioscopique/cœlioscopique robot-assistée a significativement augmenté sur les deux périodes (35 % versus 39 %, p <0,0001). En revanche, cette augmentation était plus importante dans le secteur public que dans le secteur privé (p =0,0017).
L’analyse de l’évolution du nombre d’interventions en fonction de l’année de la chirurgie a mis en évidence une augmentation linéaire de la NP cœlioscopique/robotique (p =0,001). Le nombre de NT a baissé significativement avec les années (p <0,001). En revanche, aucune corrélation entre le nombre de NT cœlioscopiques et le nombre de NP ouvertes n’a été mise en évidence (Figure 1).
Figure 1.
Évolution de la chirurgie rénale en France de 2009 à 2012. NTC : néphrectomie totale cœlioscopique ; NTO : néphrectomie totale ouverte ; NPO : néphrectomie partielle ouverte ; NPC : néphrectomie partielle cœlioscopique.
Les recommandations constituent un référentiel commun pour les pratiques en chirurgie onco-urologique. Cependant, il est difficile d’évaluer leur impact direct sur les décisions thérapeutiques. En effet, le texte donne une ligne directrice, alors que la pratique quotidienne fait face à plusieurs facteurs ; tels l’état de santé général du patient, sa situation sociale, la disponibilité d’un plateau de soins adéquat, la préférence du patient et la formation du chirurgien. Parfois, ces facteurs nécessitent un ajustement de la prise en charge par rapport à la recommandation générale.
L’évolution du texte des recommandations françaises est en adéquation avec les recommandations européennes insistant sur la priorité accordée à la chirurgie partielle [8]. À notre connaissance, aucune étude n’a rapporté la conformité des pratiques réelles aux recommandations. La disponibilité des données au sein de la base de données de l’ATIH est un moyen indirect d’évaluer l’évolution des pratiques. Cette base de données a trois avantages principaux qui sont :
• | la disponibilité de données à l’échelle nationale ;
|
• | avec des indications précises sur le type d’actes en utilisant la CCAM ;
|
• | provenant des secteurs privé et public.
|
Les résultats ont mis en évidence une augmentation significative des interventions. Cette augmentation peut être le reflet d’une augmentation générale de l’incidence des masses rénales, d’un interventionnisme plus important de la part des chirurgiens ou les deux associés. L’absence de données précises sur l’incidence des masses rénales (et non du RCC), de la surveillance active (SA) et du nombre de traitements ablatifs ne permet pas de répondre d’une façon précise à cette question.
À l’analyse de la courbe d’évolution, les nouveaux actes étaient en accord avec les recommandations en vigueur en privilégiant la NP et la voie mini-invasive. Il y avait une baisse significative de la NT en faveur de la NP. La baisse de la chirurgie radicale s’est faite essentiellement aux dépens de la voie ouverte et le gain de chirurgie partielle était au profit la voie laparoscopique. L’essor de la NP cœlioscopique/cœlioscopique robot-assistée était plus marqué dans le secteur public que dans le secteur privé. Ceci peut être expliqué par la diffusion, proportionnellement plus importante, des robots dans les hôpitaux publics et PSPH, d’une part, et de la disponibilité d’infrastructures plus lourdes (plateaux techniques, unité de soins intensifs), d’autre part.
Nous pensons que le maintien du nombre d’actes de NP ouverte alors que la NP cœlioscopique/cœlioscopique robot-assistée augmente (alors qu’il est censé diminuer) est dû à un transfert d’interventions (vases communicants) : les masses qui étaient traitées auparavant par NT sont désormais traitées par NP. Cette évolution montre que les urologues français ont favorisé la préservation néphronique par rapport à la voie chirurgicale. Une attitude contraire a été rapportée par Abouassaly et al. qui ont analysé le registre de cancérologie de la province de l’Ontario (Canada) entre 1995 et 2004. Leurs résultats ont mis en évidence un impact négatif de l’introduction de la NT cœlioscopique sur la NP suggérant le choix des chirurgiens de réaliser une NT cœlioscopique plutôt qu’une NP ouverte [9].
Une des limites de cette étude était l’absence de données médicales individuelles précises dans la base de l’ATIH. Les seules indications qui pouvaient être extraites étaient basées sur l’intitulé du GHM (groupe homogène de patient) pour indiquer que la chirurgie qui avait été pratiquée concernait bien une atteinte cancéreuse. Il n’était pas possible de vérifier l’adéquation des indications avec les recommandations en vigueur. Aussi, l’acquisition des données par l’ATIH se fait sur la base d’une déclaration par le chirurgien sans deuxième contrôle. Des erreurs lors du processus de déclaration ne peuvent donc pas être exclues. Cependant, la quantité d’interventions ayant été importante, l’impact de ce biais reste limité. Enfin, il était difficile d’avoir des données sur la SA et des traitements ablatifs des petites masses rénales. En effet, cette option thérapeutique a été introduite avec l’objectif de réduire la morbidité des traitements chirurgicaux chez les personnes dont le pronostic vital n’est pas menacé par une masse rénale découverte fortuitement et dont le rapport bénéfice–risque n’est pas en faveur de la chirurgie [10]. Par ailleurs, à défaut d’un code CCAM spécifique à la chirurgie robotique, les interventions étaient classées par défaut dans le groupe « cœlioscopie ». Par conséquent, la proportion des interventions robot-assistées était impossible à déterminer.
Enfin, outre le critère technique et d’élégance, il faut garder à l’esprit les conséquences en termes de morbidité et de progression ultérieure de la NP. Si le rationnel de celle-ci est admis par la communauté urologique, il n’existe pas, à l’heure actuelle, une étude avec un niveau de preuve suffisant, démontrant la supériorité voire la non-infériorité de la NP sur la NT. En dépit de toutes les critiques méthodologiques que l’on peut lui opposer, le seul essai randomisé disponible (étude de l’EORTC 30904 : NP versus NT) a mis en évidence une survie globale inférieure dans le bras NP en analyse en intention de traiter [11].
Cette étude a mis en évidence la concordance des actes de chirurgie rénale réalisés en France entre 2009 et 2012 avec l’évolution du texte de recommandations françaises. Elle a mis en évidence l’essor de la chirurgie partielle du rein et la voie mini-invasive. Sur la période étudiée, l’évolution de cette dernière était plus importante dans le secteur public.
Les auteurs déclarent ne pas avoir de conflits d’intérêts en relation avec cet article.
Annexe 1. Codes de la classification commune des actes médicaux (CCAM) utilisés.
|
| Néphrectomie | Voie | CCAM | Néphrectomie | Voie | CCAM | | Partielle | Ouverte | JAFA007 | Élargie | Ouverte | JAFA005 | | Partielle | Ouverte | JAFA008 | Élargie | Ouverte | JAFA009 | | Partielle | Ouverte | JAFA019 | Élargie | Ouverte | JAFA011 | | Partielle | Ouverte | JAFA024 | Élargie | Ouverte | JAFA014 | | Partielle | Ouverte | JAFA026 | Élargie | Ouverte | JAFA021 | | Partielle | Ouverte | JAFA030 | Élargie | Ouverte | JAFA022 | | Partielle | Cœlioscopique | JAFC002 | Élargie | Ouverte | JAFA025 | | Partielle | Cœlioscopique | JAFC005 | Élargie | Ouverte | JAFA028 | | Partielle | Cœlioscopique | JAFC007 | Élargie | Ouverte | JAFA029 | | Partielle | Cœlioscopique | JAFC008 | Élargie | Ouverte | JAFA031 | | Totale | Ouverte | JAFA002 | Élargie | Cœlioscopique | JAFC010 | | Totale | Ouverte | JAFA010 | Élargie | Cœlioscopique | JAFC019 | | Totale | Ouverte | JAFA012 | Totale | Ouverte | JAFA032 | | Totale | Ouverte | JAFA016 | Totale | Cœlioscopique | JAFC001 | | Totale | Ouverte | JAFA023 | Totale | Cœlioscopique | JAFC004 | | Totale | Ouverte | JAFA027 | Élargie | Cœlioscopique | JAFC006 |
|
Annexe 2. Matériel complémentaire
 | (105 Ko) |
| Tableau S1 |
| Tableau S1. Nombres d’actes de chirurgie déclarés entre 2009 et 2012. |