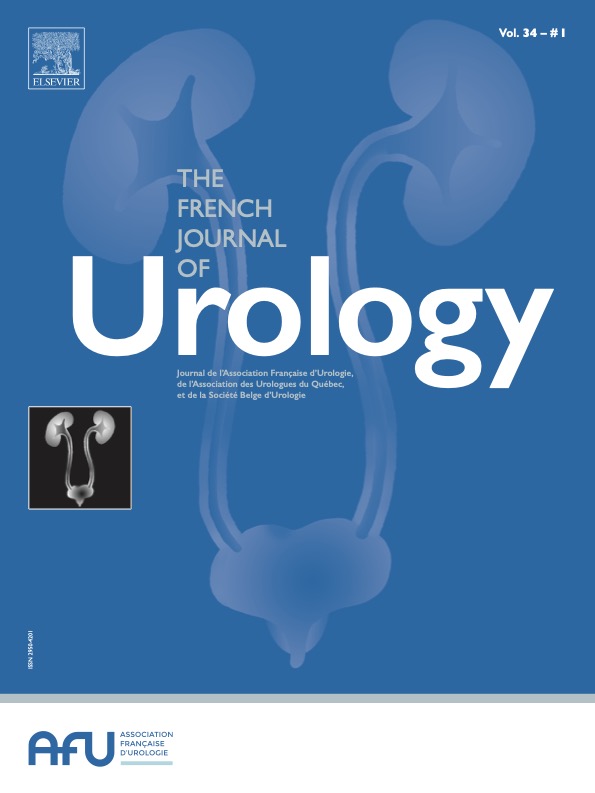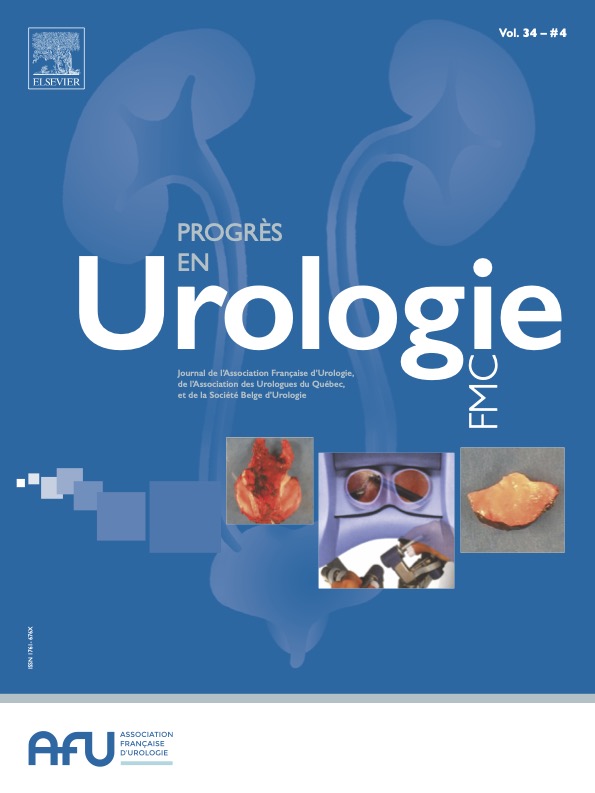Recommandations du Comité Lithiase de l’Association Française d’Urologie pour la prise en charge des calculs urinaires durant la crise sanitaire liée à la pandémie à COVID-19
Confrontés à une crise d’une ampleur exceptionnelle liée à la pandémie à coronavirus COVID-19 responsable d’une saturation selon les régions des urgences et des places en réanimation, le Comité Lithiase de l’Association Française d’Urologie (CLAFU) a élaboré pour la première fois les recommandations de prise en charge des calculs urinaires durant cette crise sanitaire.
Le texte complet de cet article est disponible en PDF.
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pour la première fois depuis la grippe « espagnole » de 1918, le système de santé français s’est retrouvé confronté à une crise de très grande ampleur liée à la pandémie à coronavirus COVID-19, responsable d’une saturation selon les régions des urgences et des places en réanimation. À l’image des différentes nations qui ont eu recours au confinement pour limiter sa progression, le système de santé français a dû repenser ses parcours, ses priorités, pour éviter la propagation de la contagion, favoriser le traitement des patients en état grave tout en assurant les urgences de chaque spécialité médicale ou chirurgicale. En France, 1 à 2 % des motifs de consultations aux urgences sont liées aux calculs urinaires [1]. Le Comité Lithiase de l’Association Française d’Urologie (CLAFU) a élaboré pour la première fois les recommandations [2, 3, 4] vis-à-vis de leur prise en charge dans ce contexte de crise sanitaire exceptionnelle. Les objectifs :
Faire face en priorité aux urgences liées aux calculs urinaires (terrain fragilisé, contexte infectieux), en prévenant leurs risques de complications graves notamment septiques dont le pronostic s’assombrit en cas de retard de prise en charge [6] et qui pourraient potentiellement nécessiter une mobilisation de moyens humains et de matériels de réanimation.
Ces recommandations devront bien sûr s’adapter à :
La programmation (Figure 1) devra se faire en raison des risques de complication et de fréquentation des urgences, dans un délai de 2 semaines. Elle devra se conformer aux modalités de dépistage d’infection à COVID-19 de l’établissement de santé d’exercice. Hors contexte d’urgence (Figure 1), un patient programmé alors dépisté COVID+doit avoir son intervention reportée. Sa reprogrammation dépendra de l’évolution de son infection COVID-19 et devra être surveillé sur le plan urologique par téléconsultation.
Figure 1.
Résumé des recommandations et indications durant la phase d’épidémie. Une colique néphrétique (en dehors du contexte de femme enceinte) devra être authentifiée par un scanner (Se 93,1 % Sp 96,6 %) [7] en raison de sa valeur diagnostique supérieure à celle de l’échographie qui nécessite de plus la présence sur place d’un radiologue et dont l’accès a été limité dans de nombreux centres. Le scanner devra renseigner la taille ainsi que la densité (UH) du calcul et pourra vérifier dans le même temps les plages pulmonaires de manière systématique à la recherche de signes d’infection à Covid-19 [8, 9] en l’absence de disponibilité de test biologique rapide dont la sensibilité serait supérieure à ce dernier. En l’absence de preuve formelle actuelle de leur innocuité [10, 11, 12] comme de leur caractère délétère [13] en présence d’une infection à Covid 19, les AINS pourront être utilisés de manière la plus ponctuelle possible en cas de colique néphrétique avérée et confirmée au scanner, mais resteront contre indiqués en présence de signes potentiels d’infection à Covid-19 (cliniques, scannographiques ou biologiques). Même si le CLAFU ne retient qu’un faible niveau de preuve d’efficacité de la thérapie médicale expulsive par alphabloquants [14], dans le contexte actuel et devant les recommandations européennes leur utilisation peut être considérée pour favoriser l’élimination d’un calcul pelvien de 5-10mm peu symptomatique [3, 15, 16] en prévenant les patients des effets secondaires potentiels (syncope, hypotension, chute, …) et en précisant sur l’ordonnance « hors AMM, dans le cadre d’une thérapie médicale expulsive, patient informé ». En cas de calcul asymptomatique non obstructif non infecté de densité <500 UH, une alcalinisation doit être proposée en plus de la surveillance [2, 3]. Les extractions de calcul par urétéroscopie sont à préférer à la lithotripsie extracorporelle (LEC) durant cette crise sanitaire en raison des risques de colique néphrétique pouvant survenir en post traitement et de l’élimination incertaine des fragments. Cependant, la LEC peut être considérée, en dehors d’un contexte infectieux, pour le traitement d’un calcul <10mm qui a été refoulé avec une sonde double J qui est bien tolérée et non incrustée, ou pour le traitement d’un calcul de la jonction urétéro-vésicale pour en accélérer l’élimination sans avoir recours à une anesthésie. En cas de carence en respirateurs ou de drogues d’anesthésie, les interventions devront être limitées aux gestes urgents en privilégiant la réalisation de drainages sous rachianesthésie. La surveillance (Figure 1) des patients lithiasiques, en l’absence de complication, peut être éventuellement effectuée en téléconsultation afin de limiter la fréquentation des établissements de santé notamment s’il existe pour l’urologue un accès informatisé aux examens d’imagerie pour les consulter. Lors de la surveillance des patients dont l’indication initiale était de différer leur prise en charge, chaque nouvelle évaluation devra se conformer aux recommandations (Figure 1) pour s’adapter à une éventuelle évolution de la pathologie : urgence, programmation ou poursuite de la surveillance. Devant une crise dont la durée et l’évolution restent indéterminées, la prévention lithiasique (conseils diététiques, …) doit être poursuivie afin de limiter les risques de récidive. Cependant, la réalisation des bilans métaboliques qui a été arrêtée durant la phase critique de l’épidémie ainsi que le confinement devra être reconsidérée avec leur allègement, notamment pour les patients à fort risque de récidive. L’analyse morpho-constitutionnelle et spectrophotométrique infrarouge des calculs, la description endoscopique des calculs [17] et la description des anomalies papillaires [19, 18] apportent des informations essentielles et rapides pour initier une orientation diagnostique et préventive.
Les auteurs ne déclarent pas avoir de liens d’intérêts. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© 2020 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||